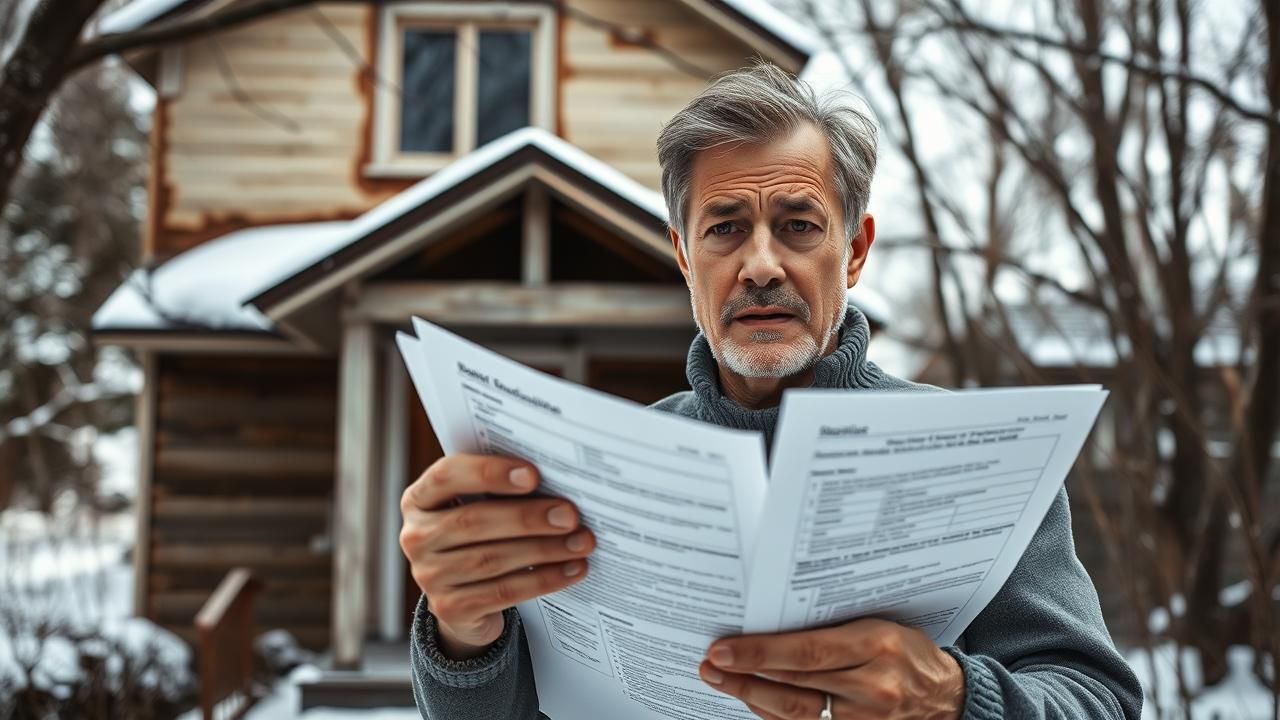Alors que la France s’engage dans une course contre la montre pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et améliorer la performance énergétique de son parc immobilier, l’annonce de la réouverture de MaPrimeRenov’ à compter du 30 septembre a suscité à la fois de l’espoir et de l’inquiétude. Initialement conçue comme un levier majeur de la transition énergétique, cette aide publique voit désormais ses conditions d’accès durcies, laissant de nombreux ménages, surtout les classes moyennes, dans une situation d’incertitude. Entre plafonds de ressources abaissés, montants de subvention réduits et quotas limités, les ambitions affichées par le gouvernement semblent entrer en contradiction avec les moyens réellement déployés. Derrière ces chiffres, ce sont des milliers de foyers qui voient leurs projets de rénovation énergétique compromis, alors même que la lutte contre le changement climatique ne souffre plus de délai.
Qui peut encore bénéficier de MaPrimeRenov’ en 2024 ?
La réforme de MaPrimeRenov’ redéfinit radicalement les profils éligibles. Désormais, seuls les ménages classés dans la catégorie « très modestes » selon les critères de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) peuvent prétendre à l’aide. Pour une personne seule résidant en dehors de l’Île-de-France et des Outre-mer, le plafond de ressources est fixé à 17 173 euros annuels. Pour un couple sans enfant, il s’élève à 25 115 euros. Chaque personne supplémentaire dans le foyer augmente légèrement ce seuil, mais les écarts restent étroits. Ces nouvelles limites excluent de facto une large part de la population, notamment les classes moyennes qui, malgré des revenus modestes, ne parviennent pas à franchir le seuil de la précarité énergétique reconnue.
Camille Lenoir, enseignante dans une petite ville du Loiret, témoigne : « J’ai un salaire stable, mais avec un logement ancien mal isolé et des factures d’énergie qui explosent chaque hiver, je pensais pouvoir enfin isoler mes combles et changer mes fenêtres grâce à MaPrimeRenov’. Mais en vérifiant les nouveaux plafonds, j’ai découvert que je gagnais 800 euros de trop. Du coup, je suis coincée : ni assez riche pour tout payer, ni assez pauvre pour être aidée. » Ce sentiment de « classe moyenne oubliée » est partagé par de nombreux Français qui, bien qu’engagés dans une démarche écologique, se retrouvent exclus du dispositif.
Les plafonds de travaux sont-ils encore réalistes ?
Le montant maximum des travaux éligibles à la subvention a été divisé par presque deux, passant de 70 000 à 40 000 euros. Une baisse drastique qui pose problème pour les rénovations globales, notamment dans les maisons individuelles anciennes. « Rénover une maison de 120 m², construite dans les années 1970, coûte facilement entre 50 000 et 80 000 euros si on veut sortir du F ou du G au DPE », explique Hugues Sartre, ingénieur thermicien au sein de GERE, un collectif d’experts en rénovation énergétique. « Avec un plafond à 40 000 euros, même en cumulant les aides, le reste à charge devient insurmontable pour la plupart des foyers. »
Le cas de Thomas et Léa Berthier, installés dans une maison à Limoges, illustre cette réalité. « On a fait un audit énergétique complet, et le devis pour isolation, chauffage, ventilation et fenêtres s’élève à 62 000 euros. On pensait que MaPrimeRenov’ couvrirait une grande partie, mais avec le nouveau plafond, on ne touche qu’une fraction. Et puis, on apprend que même si on est éligible, il faut espérer que notre dossier passe avant que les 13 000 places ne soient prises. C’est décourageant. »
Par ailleurs, la suppression du « bonus sortie de passoire énergétique » – une aide supplémentaire pour les logements classés F ou G – est perçue comme un recul majeur. Ce coup de pouce encourageait justement les propriétaires à aller au bout de la rénovation. Sans lui, de nombreux projets risquent de se limiter à des travaux superficiels, insuffisants pour réduire durablement la consommation énergétique.
Un quota de 13 000 dossiers : une goutte d’eau dans l’océan des besoins
Le chiffre frappe par son insuffisance : 13 000 nouveaux dossiers seulement seront acceptés d’ici la fin de l’année. Ce quota, fixé par le ministère du Logement, intervient alors que 61 000 demandes sont encore en attente de traitement. « C’est une goutte d’eau », s’insurge Audrey Zermati, porte-parole du groupe Effy, spécialisé dans les solutions de rénovation énergétique. « On parle d’un million de passoires énergétiques en France. Même si on atteint 62 000 rénovations globales en 2025, comme le prévoit le gouvernement, cela représente moins de 0,1 % du parc concerné. C’est symbolique, pas efficace. »
La course au quota risque de devenir une loterie. Les premiers déposants seront les seuls à bénéficier de l’aide, sans considération pour l’urgence ou la gravité du besoin. « Ce n’est plus une politique publique, c’est une loterie sociale », estime Pierre-François Morin, fondateur de Hello Watt, une plateforme d’accompagnement à la transition énergétique. « On demande aux citoyens de s’engager, mais on ne leur donne ni les moyens ni la sécurité. »
Pour les professionnels du bâtiment, cette incertitude freine également les investissements. « Nos artisans hésitent à proposer des devis complets, car ils savent que leurs clients risquent de ne pas obtenir l’aide », explique Inès Chakroun, coordinatrice de chantiers chez un réseau de rénovateurs en Auvergne. « Du coup, on fait moins de diagnostics, moins de projets ambitieux. C’est tout le secteur qui ralentit. »
Les ménages sont-ils abandonnés face à l’urgence climatique ?
Alors que les étés deviennent de plus en plus caniculaires et les hivers plus rigoureux, la vulnérabilité énergétique des logements anciens ne cesse de s’aggraver. Pourtant, les mesures prises semblent aller à l’encontre d’une réponse à la hauteur du défi. « On a un besoin massif de rénovation, mais on restreint l’accès à l’aide au moment où il faudrait l’élargir », constate Camille Lenoir, dont le témoignage reflète une frustration croissante. « On nous parle d’écologie, mais concrètement, on nous dit : débrouillez-vous. »
Le paradoxe est frappant : l’État affiche des objectifs ambitieux – sortir 20 000 passoires énergétiques par an du F/G d’ici 2027 –, mais les outils mis en œuvre sont sous-financés et restrictifs. « Ce n’est pas une politique de rénovation, c’est une politique de communication », tranche Hugues Sartre. « On donne l’impression d’agir, mais on ne change pas la donne. »
Les ménages les plus précaires, bien que prioritaires, ne sont pas les seuls à souffrir. Les classes moyennes, souvent propriétaires de maisons anciennes dans les zones rurales ou périurbaines, se retrouvent coincées entre des aides inaccessibles et des coûts de travaux prohibitifs. « On ne vit pas dans le luxe, mais on paie nos impôts, on entretient notre bien, et pourtant, on n’a pas droit à l’aide », déplore Thomas Berthier. « C’est un sentiment d’injustice. »
Quelles alternatives pour les foyers exclus ?
Faute de subvention, certains ménages se tournent vers des solutions alternatives : prêts à taux zéro, aides locales, ou autofinancement. Mais ces options ne sont pas accessibles à tous. « Les banques hésitent à prêter sur des projets de rénovation sans garantie claire de retour sur investissement », explique Inès Chakroun. « Et les aides locales varient énormément d’un territoire à l’autre. »
D’autres, comme Camille Lenoir, envisagent de repousser leurs travaux à plus tard, en espérant une assouplissement des conditions. « Je vais commencer par changer mes ampoules et décrasser mon chauffage. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est ce que je peux faire. »
Des initiatives citoyennes émergent également, comme les coopératives de rénovation ou les groupements d’achat. Mais leur portée reste limitée. « Ce sont des solutions de niche, pas un plan national », souligne Pierre-François Morin. « Il faut une relance massive, pas des rustines. »
Quel avenir pour la rénovation énergétique en France ?
La question n’est plus seulement technique ou financière, elle est politique. La transition énergétique ne pourra réussir que si elle est inclusive, c’est-à-dire qu’elle intègre tous les ménages, quel que soit leur niveau de revenu. « On ne peut pas laisser la rénovation énergétique devenir un luxe », insiste Audrey Zermati. « Sinon, on creuse les inégalités sociales et territoriales. »
Les experts appellent à une refonte du dispositif : élargir les plafonds de ressources, augmenter les montants d’aide, supprimer les quotas, et mieux accompagner les ménages dans leurs démarches. « Il faut un guichet unique, simple, et des aides préfinancées pour éviter les délais interminables », propose Hugues Sartre. « Et surtout, il faut du courage politique. »
Le défi est immense, mais les solutions existent. Il reste à savoir si le gouvernement est prêt à les mettre en œuvre à la hauteur de l’urgence climatique et sociale.
A retenir
Qui est éligible à MaPrimeRenov’ désormais ?
Seuls les ménages classés « très modestes » peuvent bénéficier de l’aide, avec des plafonds de ressources abaissés à 17 173 euros pour une personne seule et 25 115 euros pour un couple, hors Île-de-France et Outre-mer. Les classes moyennes sont largement exclues.
Pourquoi les plafonds de travaux ont-ils été réduits ?
Le montant maximum des travaux éligibles est passé de 70 000 à 40 000 euros, probablement en raison de contraintes budgétaires. Cette baisse rend difficile la réalisation de rénovations globales, surtout pour les maisons individuelles.
Que signifie le quota de 13 000 dossiers ?
Le ministère limite à 13 000 le nombre de nouveaux dossiers acceptés d’ici la fin de l’année. Au-delà, la plateforme sera fermée, ce qui crée une course au dépôt de dossier et laisse beaucoup de ménages sans solution.
La suppression du bonus pour sortie de passoire énergétique a-t-elle un impact ?
Oui. Ce bonus incitait fortement les propriétaires à réaliser des rénovations ambitieuses. Sa suppression risque de limiter les projets à des travaux partiels, moins efficaces sur le plan énergétique.
Les ménages ont-ils encore des alternatives ?
Les alternatives existent – prêts, aides locales, autofinancement – mais elles sont inégalement accessibles. Les solutions collectives comme les coopératives de rénovation émergent, mais leur impact reste limité sans soutien public fort.