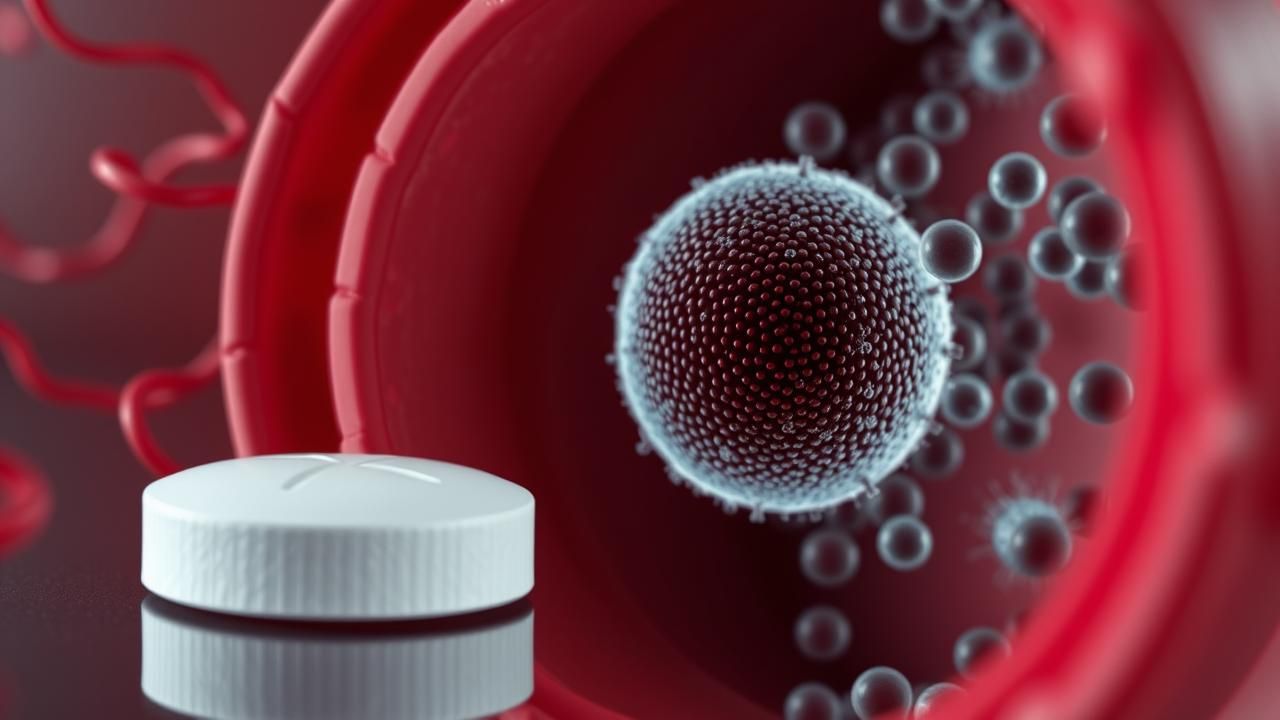En 2025, une étude menée par des chercheurs de l’université de Cambridge a relancé un débat scientifique vieux de plusieurs décennies : et si un médicament aussi banal qu’une aspirine pouvait jouer un rôle crucial dans la lutte contre le cancer ? Ce n’est pas une annonce prématurée ni une rumeur de salon médical, mais une découverte publiée dans la prestigieuse revue Nature, qui pourrait bien redéfinir notre approche des métastases. Ce qui semblait être un effet secondaire anecdotique chez certains patients traités pour des affections cardiovasculaires s’est transformé en piste thérapeutique majeure. L’aspirine, ce petit comprimé blanc connu pour soulager les maux de tête, pourrait avoir le pouvoir de libérer les défenses immunitaires bloquées par les cellules cancéreuses. Loin d’un simple coup de chance, cette découverte ouvre une voie inédite dans la guerre contre les cancers solides, notamment ceux du côlon, du sein ou de l’estomac.
Comment l’aspirine, un antalgique classique, a-t-elle pu révéler un effet anticancéreux ?
Le chemin qui a mené à cette percée n’était pas direct. L’équipe de recherche dirigée par le Dr Rahul Roychoudhuri étudiait initialement le rôle des plaquettes sanguines dans la dissémination des cellules tumorales chez des souris modèles. Leur objectif : comprendre pourquoi certaines tumeurs parviennent à échapper à la surveillance immunitaire. Ce qu’ils ont observé a dépassé leurs attentes. Chez les animaux traités à faible dose d’aspirine, les métastases étaient nettement moins fréquentes. Cette observation, déjà suggérée par des études épidémiologiques antérieures, a pris une nouvelle dimension lorsqu’ils ont identifié le mécanisme biologique sous-jacent.
Quel est le rôle des lymphocytes T dans la lutte contre le cancer ?
Les lymphocytes T sont des acteurs clés du système immunitaire. Ils agissent comme des agents de renseignement mobiles, capables de reconnaître les cellules anormales et de les éliminer. Dans un organisme sain, ces cellules patrouillent constamment, prêtes à neutraliser toute menace. Mais dans l’environnement tumoral, leur efficacité est souvent compromise. Les cellules cancéreuses ont développé des stratégies sophistiquées pour les neutraliser, notamment en recrutant des alliés inattendus : les plaquettes sanguines.
Comment les plaquettes sanguines trahissent-elles le système immunitaire ?
Les plaquettes, généralement associées à la coagulation, jouent un rôle insidieux dans la progression du cancer. Lorsqu’une cellule tumorale se détache de la masse principale pour migrer vers d’autres organes, elle s’entoure de plaquettes, qui la protègent comme un bouclier. Ces plaquettes libèrent une molécule appelée thromboxane A2 (TXA2), qui envoie un signal aux lymphocytes T : « Ne pas intervenir ». Ce signal bloque leur activité, permettant à la cellule cancéreuse de voyager en toute impunité. C’est une trahison au sein même du système de défense.
Quel est l’effet de l’aspirine sur ce mécanisme ?
L’aspirine, même à faible dose, inhibe la production de thromboxane A2. En supprimant ce signal de « stand-by », elle libère les lymphocytes T de leur inhibition. Ces cellules retrouvent alors leur capacité à identifier et détruire les cellules cancéreuses en migration. « C’est comme si les plaquettes donnaient un ordre de retrait aux soldats du système immunitaire, explique Rahul Roychoudhuri. L’aspirine empêche ce message de passer. » Le moment d’action est crucial : juste après le départ de la tumeur primaire, lorsque les cellules sont isolées et vulnérables. C’est là que l’aspirine frappe le plus efficacement.
Pour quels types de cancer cette découverte est-elle particulièrement prometteuse ?
La recherche montre que l’effet protecteur de l’aspirine n’est pas universel. Il est principalement observé chez les adénocarcinomes, un groupe de cancers qui inclut les tumeurs du côlon, de l’estomac, du sein et du poumon. Ces cancers ont en commun une interaction forte avec les plaquettes durant la phase de dissémination. Leur environnement tumoral favorise la formation de ce bouclier plaquettaire, ce qui rend leur propagation sensible à l’inhibition du TXA2.
Pourquoi certains cancers ne répondent-ils pas à ce mécanisme ?
Les cancers comme les sarcomes ou certains lymphomes, qui ne dépendent pas fortement des interactions plaquettes-immunité, ne semblent pas bénéficier de cet effet. Cela explique pourquoi les études épidémiologiques montrent des résultats contrastés selon les types de tumeurs. La clé réside donc dans la biologie même de chaque cancer : plus il utilise les plaquettes pour échapper à l’immunité, plus l’aspirine peut être efficace.
Quelles données chiffrées soutiennent cette hypothèse ?
Une méta-analyse publiée dans The Lancet a compilé les données de plusieurs essais cliniques portant sur des patients atteints de cancer colorectal. Elle révèle que la prise quotidienne d’aspirine à faible dose (75 à 300 mg) réduit de 36 % le risque de métastases. Plus impressionnant encore, elle divise par deux la mortalité chez les patients diagnostiqués à un stade précoce. Ces chiffres, bien que préliminaires, suggèrent un impact clinique majeur.
Peut-on envisager l’aspirine comme traitement anticancéreux ?
La question est légitime, mais la réponse exige prudence. Aujourd’hui, plus de 10 000 patients participent à un essai clinique international coordonné entre le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Inde. Ce programme, baptisé ASPIRE-Cancer, vise à évaluer l’efficacité de l’aspirine en tant qu’adjuvant thérapeutique après chirurgie d’un cancer du côlon. Les résultats, attendus en 2027, pourraient déterminer si ce traitement devient une recommandation standard.
Quels sont les risques liés à la prise d’aspirine ?
L’aspirine, bien qu’accessible et bon marché, n’est pas anodine. Elle augmente le risque de saignements gastro-intestinaux, d’ulcères et, dans de rares cas, d’accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Ceux qui ont des antécédents de troubles de la coagulation ou de gastrite doivent particulièrement éviter son usage sans surveillance médicale. « Ce n’est pas un complément alimentaire », insiste la Dr Hélène Lefebvre, oncologue à l’hôpital Cochin. « C’est un médicament actif, avec des effets indésirables réels. »
Qui pourrait bénéficier de ce traitement ?
Les patients à haut risque de récidive, notamment ceux ayant un cancer du côlon avec invasion vasculaire ou ganglionnaire, pourraient être les premiers concernés. Mais la décision doit être personnalisée. L’âge, le terrain médical, la présence d’autres traitements (comme les anticoagulants) doivent être pris en compte. C’est pourquoi l’automédication est fortement déconseillée.
Quel avenir pour les traitements inspirés de l’aspirine ?
L’objectif ultime n’est pas de faire de l’aspirine un traitement universel contre le cancer, mais d’en tirer les principes pour concevoir de nouvelles molécules. « On rêve d’un médicament qui imite l’effet de l’aspirine sur le TXA2, mais sans toucher aux autres voies de la coagulation », explique le Pr Antoine Mercier, pharmacologue à l’Institut Pasteur. Ce type de cible ouvre la voie à une nouvelle classe de traitements : des immunomodulateurs plaquettaires, capables de renforcer l’immunité sans les risques hémorragiques.
Comment cela pourrait-il transformer l’immunothérapie ?
L’immunothérapie, bien que révolutionnaire, reste coûteuse et inefficace pour une partie des patients. Elle cible des checkpoints immunitaires comme PD-1 ou CTLA-4, mais ne s’attaque pas aux mécanismes de dissémination. L’approche par inhibition du TXA2 agirait en amont, en empêchant les cellules cancéreuses de fuir la tumeur primaire. Combinée à l’immunothérapie, elle pourrait offrir une stratégie plus complète. « C’est une arme complémentaire, pas concurrente », précise le Dr Roychoudhuri.
A retenir
Quelle est la découverte majeure sur l’aspirine et le cancer ?
Des chercheurs de Cambridge ont découvert que l’aspirine, à faible dose, inhibe le thromboxane A2 produit par les plaquettes. Cette molécule bloque les lymphocytes T, empêchant l’immunité de détruire les cellules cancéreuses en migration. En supprimant ce signal, l’aspirine permet aux défenses immunitaires de traquer efficacement les cellules métastatiques.
Quels cancers sont concernés par cet effet ?
Les adénocarcinomes, notamment les cancers colorectaux, gastriques, du sein et du poumon, sont les plus sensibles. Ces tumeurs interagissent fortement avec les plaquettes durant la dissémination, ce qui rend leur propagation vulnérable à l’aspirine.
L’aspirine peut-elle prévenir le cancer ?
Elle ne prévient pas le développement d’un cancer, mais elle pourrait réduire significativement le risque de métastases chez des patients déjà diagnostiqués. Une méta-analyse indique une baisse de 36 % du risque de dissémination et une mortalité divisée par deux à stade précoce.
Est-il conseillé de prendre de l’aspirine contre le cancer ?
Non, pas sans avis médical. L’aspirine comporte des risques, notamment hémorragiques. Elle ne doit pas être utilisée en automédication. Des essais cliniques sont en cours pour déterminer les bénéfices réels et les profils de patients éligibles.
Quel est l’avenir de cette découverte ?
Elle pourrait conduire au développement de nouveaux traitements ciblant spécifiquement l’interaction plaquettes-immunité, sans les effets secondaires de l’aspirine. Ces molécules pourraient devenir des adjuvants précieux dans la prévention des récidives, surtout dans les pays à ressources limitées, où les traitements coûteux sont inaccessibles.
Conclusion
La découverte de l’effet antimétastatique de l’aspirine est un exemple fascinant de sérendipité scientifique. Ce médicament, vieux d’un siècle, révèle encore des facettes insoupçonnées. Mais au-delà de l’aspirine elle-même, c’est une nouvelle compréhension du cancer que cette recherche apporte : celle de l’importance des interactions entre tumeurs, plaquettes et immunité. Elle ouvre la porte à des stratégies préventives simples, accessibles, et potentiellement révolutionnaires. Comme le dit souvent Élodie Renard, patiente atteinte d’un cancer du côlon et participante à l’essai ASPIRE-Cancer : « Savoir qu’un petit comprimé pourrait empêcher que le cauchemar recommence… c’est une lueur d’espoir. » L’espoir, justement, est peut-être là : pas dans un traitement miracle, mais dans une arme discrète, déjà entre nos mains, que la science apprend enfin à bien utiliser.