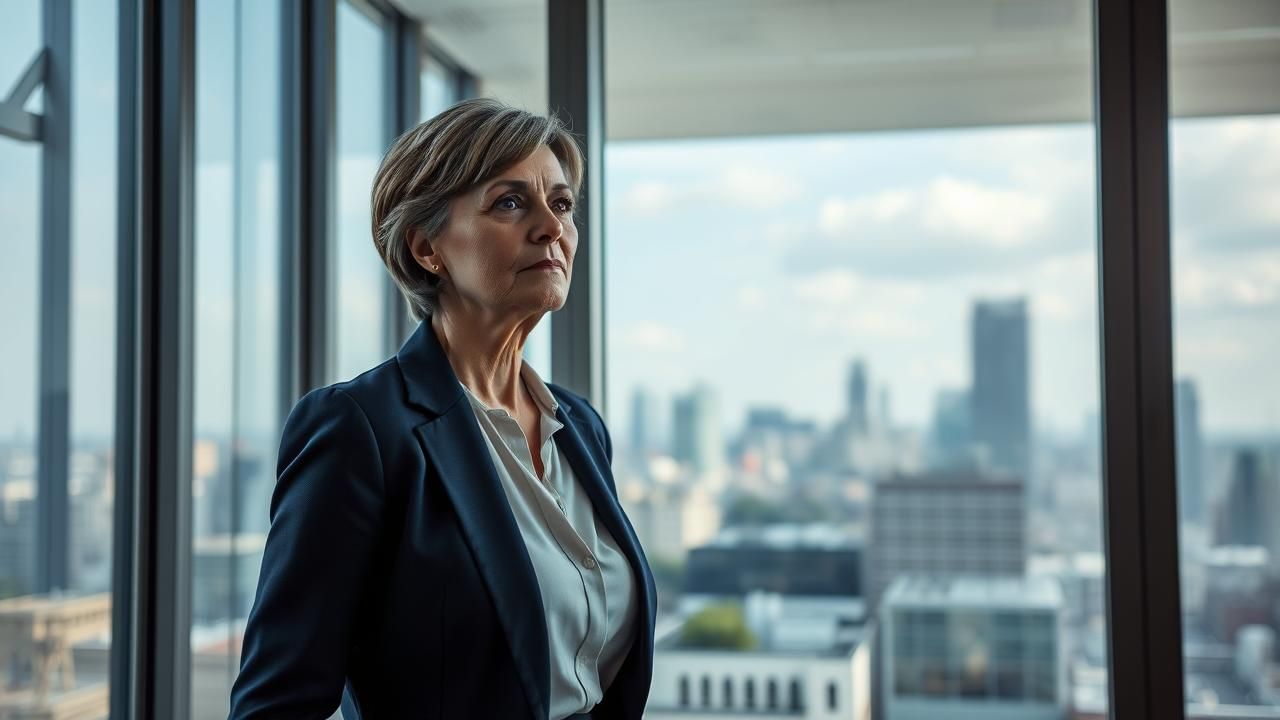Alors que la France s’apprête à vivre une nouvelle journée de mobilisation sociale, le gouvernement tente de tendre des perches pour apaiser les tensions autour du système de retraite. Sébastien Lecornu, fraîchement installé à Matignon, a choisi un moment stratégique pour envoyer un courrier aux principales organisations syndicales. Dans ce document, il annonce que l’amélioration des retraites des femmes figurera au cœur du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026. Une promesse qui fait écho aux pistes abandonnées lors du « conclave » sur les retraites, un processus de concertation avorté en juin dernier. Si cette annonce vise à rassurer, elle suscite aussi scepticisme et frustration, tant les attentes sociales dépassent largement ce cadre ciblé. Entre inégalités persistantes, revendications non satisfaites et tensions budgétaires, l’enjeu est désormais de savoir si ces mesures seront perçues comme un pas en avant ou comme une simple manœuvre politique.
Quelles inégalités structurelles pèsent sur les retraites des femmes ?
En France, l’écart moyen entre les pensions des hommes et celles des femmes s’élève à 40 %, selon les données de la Drees. Ce fossé n’est pas le fruit du hasard, mais d’un système qui pénalise historiquement les parcours professionnels atypiques, souvent marqués par des interruptions pour élever des enfants, des temps partiels imposés ou des carrières moins linéaires. Pour Camille Rambert, 58 ans, cadre dans une entreprise de logistique à Lyon, cette réalité est quotidienne. « J’ai travaillé sans interruption pendant vingt ans, mais j’ai eu deux enfants. Entre congés maternité, mi-temps pour les accompagner à l’école, et un salaire inférieur à celui de mes collègues masculins, je sais que ma retraite sera bien en dessous de la moyenne. » Son témoignage reflète une situation vécue par des millions de femmes : des contributions réduites, des années incomplètes, et un calcul de pension qui ne tient pas suffisamment compte des aléas de la vie familiale.
Pourquoi le « conclave » sur les retraites a-t-il échoué ?
Entre février et juin 2025, un groupe de travail baptisé « conclave » a réuni syndicats, patronat et représentants de l’État pour tenter de trouver des compromis sur les retraites. L’objectif était d’apaiser le climat social après la réforme de 2023, qui a repoussé l’âge légal de départ à 64 ans. Mais les discussions ont buté sur des sujets sensibles : la prise en compte de la pénibilité au travail, la reconnaissance des carrières longues, et surtout, les inégalités de genre. Malgré des avancées partielles, aucun consensus n’a été trouvé. Les syndicats reprochaient au gouvernement un manque de volontarisme, tandis que l’Exécutif jugeait les propositions trop coûteuses. L’échec du conclave a laissé un goût d’inachevé, et c’est précisément sur ce terrain que Sébastien Lecornu tente aujourd’hui de rebâtir un dialogue.
Quelles mesures concrètes sont-elles proposées ?
Le courrier de Lecornu reprend deux pistes issues des discussions du conclave, désormais chiffrées à 200 millions d’euros chacune d’ici 2030. La première concerne la prise en compte de 24 meilleures années pour le calcul de la pension des femmes ayant eu un enfant, contre 25 aujourd’hui pour tous les assurés. Pour celles ayant eu deux enfants ou plus, ce seuil passerait à 23 meilleures années. Cette mesure vise à compenser les périodes de faible revenu ou d’absence du marché du travail liées à la maternité. La seconde proposition permettrait aux femmes ayant validé des trimestres supplémentaires pour maternité de les intégrer dans le dispositif « carrière longue ». Actuellement, seuls les trimestres cotisés comptent pour un départ anticipé. Cette assouplissement pourrait bénéficier à des milliers de femmes ayant commencé à travailler jeunes, mais dont les interruptions ont bloqué l’accès à cette dispense.
Ces mesures suffisent-elles à combler les inégalités ?
Si ces propositions sont accueillies comme un signal positif par certains experts, elles restent insuffisantes selon plusieurs observateurs. « Prendre en compte moins d’années, c’est bien, mais cela ne règle pas le fond du problème », explique Élodie Charpentier, économiste spécialisée dans les politiques sociales. « Le vrai enjeu, c’est la valorisation des périodes de maternité, la revalorisation des emplois majoritairement féminisés, et une meilleure reconnaissance des carrières fragmentées. » Pour elle, ces mesures sont des ajustements techniques, pas une transformation structurelle du système. D’ailleurs, des pays comme la Suède ou l’Allemagne ont mis en place des systèmes de compensation plus ambitieux, intégrant directement les années de parentalité dans le calcul des pensions, sans pénalité.
Quel impact concret pour les femmes concernées ?
Les simulations réalisées par la Drees montrent que, pour une femme ayant eu deux enfants et travaillé à temps partiel pendant dix ans, la mesure sur les 23 meilleures années pourrait augmenter sa pension de 8 à 12 %. Une différence non négligeable, mais qui reste en deçà des attentes. « C’est un peu comme si on me donnait un pansement alors que j’ai besoin d’une opération », ironise Camille Rambert. « Je ne veux pas de mesures symboliques. Je veux que mon travail, mes sacrifices, soient vraiment reconnus. » Ce sentiment est partagé par de nombreuses femmes, notamment celles qui ont exercé des métiers peu valorisés, comme l’aide à domicile ou l’éducation, où les salaires sont faibles et les carrières longues mais mal rémunérées.
Pourquoi les syndicats restent-ils sceptiques ?
La réponse des syndicats à la lettre de Lecornu a été cinglante. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, parle d’un « hors sujet complet ». Pour elle, le cœur du problème n’est pas là. « Nous ne demandons pas des mesures ciblées sur les femmes, nous demandons l’abrogation de la réforme de 2023, qui a repoussé l’âge de départ à 64 ans et pénalise les travailleurs pénibles », affirme-t-elle. La CFDT, plus mesurée, rappelle qu’elle a participé loyalement aux négociations du conclave pendant six mois. « Nous avons fait des efforts, mais le gouvernement n’a pas suivi sur la pénibilité. Aujourd’hui, il propose des mesures qui ne répondent pas à l’urgence sociale », déplore son secrétaire général. Pour les syndicats, ces annonces apparaissent comme une tentative de diviser les revendications, en isolant les femmes des autres catégories de travailleurs.
Quel rôle joue la pénibilité dans le débat ?
La question de la pénibilité reste un point de blocage majeur. Des milliers de travailleurs, notamment dans le bâtiment, la santé ou le transport, subissent des conditions physiques extrêmes. Pour eux, atteindre 64 ans dans de bonnes conditions est souvent impossible. Le conclave avait proposé de créer un dispositif de départ anticipé pour les travailleurs en situation d’usure professionnelle, mais les financements n’ont pas été validés. « On parle des femmes, mais on oublie les aides-soignantes, les infirmières, les caissières, qui ont des corps usés par des années de station debout, de manutention, de stress », souligne Thomas Lenoir, 52 ans, infirmier en EHPAD à Bordeaux. « Moi, j’ai mal partout. Je ne veux pas partir à 64. Je veux partir quand mon corps le permettra. »
Le gouvernement peut-il vraiment instaurer un nouveau dialogue ?
Lecornu insiste sur sa volonté de « rétablir un dialogue social ». Outre les mesures pour les femmes, il ouvre la porte à des discussions sur l’assurance chômage, notamment sur les ruptures conventionnelles, un sujet sensible pour les salariés. Mais la crédibilité de cette ouverture est mise à mal par le contexte. « On ne reconstruit pas la confiance avec des lettres et des annonces partielles », tempère Agnès Vasseur, négociatrice à la CFTC. « Il faut des actes forts, des engagements clairs, et surtout, écouter ceux qui sont en première ligne. » Le Premier ministre semble conscient du défi. Dans son courrier, il reconnaît que « les fractures sociales sont profondes » et que « le temps des décisions unilatérales est révolu ». Mais les syndicats restent sur leurs gardes.
Et après ? Un budget sous tension
Le projet de budget 2026 sera dévoilé à l’automne, dans un contexte économique tendu. La croissance ralentit, les déficits persistent, et chaque euro compte. Dans ce cadre, les 400 millions d’euros dédiés aux mesures pour les femmes représentent un effort, mais restent modestes face aux enjeux. « Le gouvernement doit faire des choix. Soit il mise sur des mesures ciblées, soit il revoit en profondeur le système », analyse Élodie Charpentier. « Pour l’instant, il choisit la voie la moins risquée. »
La bataille des retraites est-elle terminée ?
Non. Les syndicats ont d’ores et déjà annoncé de nouvelles mobilisations. La CGT et la CFDT appellent à une grève interprofessionnelle en novembre. « Ce n’est pas une question de femmes ou d’hommes, c’est une question de justice sociale », martèle Sophie Binet. « Nous voulons une retraite digne, accessible à tous, et qui prenne en compte la réalité des vies. » Pour Camille Rambert, comme pour des milliers d’autres, le combat continue. « Je ne veux pas d’une retraite au rabais. Je veux que mes quarante ans de travail comptent, vraiment. »
A retenir
Quelles sont les mesures annoncées pour les retraites des femmes ?
Le gouvernement propose de prendre en compte 24 meilleures années pour le calcul de la pension des femmes ayant eu un enfant, et 23 pour celles ayant eu deux enfants ou plus. Il envisage aussi d’intégrer les trimestres de maternité dans le dispositif « carrière longue », permettant un départ anticipé avant 64 ans.
À quel coût ces mesures sont-elles chiffrées ?
Chaque mesure est estimée à 200 millions d’euros d’ici 2030, soit un total de 400 millions pour les deux dispositifs.
Pourquoi les syndicats rejettent-ils ces annonces ?
Les syndicats jugent ces mesures insuffisantes et déconnectées des principales revendications, notamment l’abrogation de la réforme de 2023 et la reconnaissance de la pénibilité au travail. Ils les perçoivent comme un geste symbolique sans portée immédiate.
Quel est l’écart moyen entre les pensions des hommes et des femmes en France ?
Il s’élève à 40 %, selon les données de la Drees, en raison de carrières plus fragmentées, de salaires inférieurs et de périodes d’interruption liées à la maternité.
Le gouvernement prévoit-il d’autres discussions sur les retraites ?
Oui, Sébastien Lecornu a indiqué vouloir poursuivre les discussions sur la pénibilité et l’usure professionnelle, ainsi qu’ouvrir un dialogue sur l’assurance chômage, notamment autour des ruptures conventionnelles.