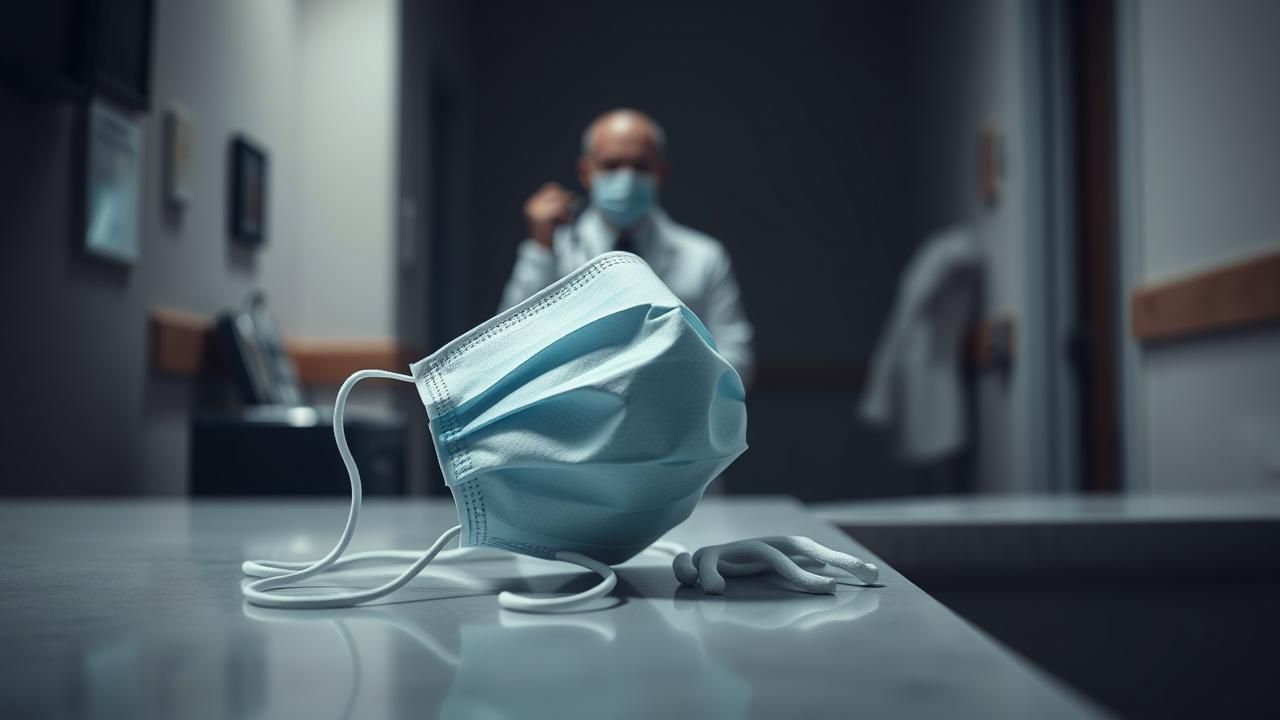Le 25 septembre 2025, une tragédie rare mais profondément ancrée dans l’actualité sanitaire française a frappé Perpignan : un homme d’une trentaine d’années est décédé de la rage, une maladie presque inconnue sur le territoire métropolitain depuis des décennies. Ce cas, exceptionnel, relance les débats sur les risques liés aux voyages dans des zones endémiques, la prévention et la vigilance face à un virus redoutablement silencieux. Alors que les autorités sanitaires mènent une enquête minutieuse, les témoignages des proches, des soignants et des experts permettent de reconstituer non seulement les circonstances de ce drame, mais aussi de mieux comprendre une maladie trop souvent oubliée en Europe.
Qui était l’homme décédé ?
L’homme, âgé de 34 ans, s’appelait Théo Léger. Employé dans une jardinerie située en périphérie de Perpignan, il était apprécié pour son calme et son sens du contact. Théo était quelqu’un de discret, mais toujours souriant. Il aimait les plantes, les animaux aussi. Il avait même recueilli un chat errant l’année dernière , raconte Lucie Berthier, sa collègue depuis cinq ans. Selon les premiers éléments recueillis, Théo a été admis à l’hôpital de Perpignan le 18 septembre avec des troubles neurologiques inexpliqués : convulsions, agitation extrême, difficulté à avaler. Rapidement, les médecins ont évoqué une suspicion de rage, diagnostic confirmé quelques jours plus tard par l’Institut Pasteur, centre national de référence pour cette maladie.
Son état s’est dégradé très vite. En quelques jours, il est passé d’un patient conscient à un tableau neurologique grave avec hydrophobie , explique le Dr Julian Cornanglia, infectiologue au CH de Perpignan. Malgré les soins intensifs, rien n’a pu enrayer l’évolution fatale du virus. Théo est décédé une semaine après son admission, entouré de sa famille, qui avait été prévenue trop tard pour qu’une intervention thérapeutique soit envisageable.
Comment a-t-il été contaminé ?
La contamination par le virus de la rage passe généralement par la salive d’un animal infecté, le plus souvent via une morsure ou une griffure. Dans le cas de Théo Léger, les prélèvements effectués ont révélé une souche canine, ce qui oriente fortement les enquêteurs vers une morsure de chien. Les analyses montrent clairement que la rage provient d’un réservoir canin, ce qui est cohérent avec les zones où ce type de transmission est encore courant , précise le Dr Cornanglia.
Pourtant, aucun animal suspect n’a été identifié dans l’entourage direct de Théo. Nous avons interrogé ses proches, ses collègues, vérifié s’il avait eu des contacts avec des chiens errants ou des animaux domestiques malades. Rien. Aucune trace de blessure récente non plus , ajoute-t-il. C’est là que l’enquête prend une autre dimension : le temps d’incubation du virus peut s’étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui rend la reconstitution des faits particulièrement délicate.
A-t-il pu contracter la rage à l’étranger ?
Oui, c’est la piste la plus probable. Selon les premiers éléments de l’enquête épidémiologique, Théo Léger s’est rendu au Maghreb plusieurs mois avant son décès, lors d’un voyage familial au Maroc. Ce détail, rapporté par sa sœur Clara, n’avait pas été jugé inquiétant à l’époque. Il était parti trois semaines, en avril. Il nous a dit avoir croisé des chiens errants, notamment dans une petite ville près de Marrakech. Il a même été griffé par l’un d’eux, mais il n’a pas vu de médecin. Il pensait que ce n’était rien , confie-t-elle, la voix brisée.
Hervé Bourhy, responsable du centre national de référence de la rage à l’Institut Pasteur, confirme que la majorité des cas de rage en France sont des importations . La rage canine est éradiquée en France depuis 2001. Tous les cas que nous avons observés ces dernières années proviennent de voyages dans des pays où la maladie circule encore, notamment en Afrique du Nord, en Asie ou en Amérique latine.
Le Maroc, bien que faisant des efforts en matière de vaccination canine, reste un pays à risque. Un simple contact avec un chien non vacciné, même sans morsure profonde, peut suffire à transmettre le virus si la salive entre en contact avec une micro-lésion , explique Bourhy. Théo, comme beaucoup de voyageurs, n’aurait peut-être pas mesuré le danger.
Qu’est-ce que le virus de la rage ?
Le virus de la rage, ou lyssavirus, attaque le système nerveux central. Il se propage à partir de la zone d’inoculation (généralement une morsure) vers le cerveau, via les nerfs périphériques. Une fois que les symptômes apparaissent, la maladie est quasi-incurable. Le virus est extrêmement efficace : il paralyse progressivement les fonctions vitales, provoque des spasmes, une hyperexcitabilité, et finit par entraîner la mort par arrêt respiratoire , décrit le Dr Cornanglia.
En Europe, les chiens ne sont plus une source de contamination, mais d’autres animaux le sont : les chauves-souris, notamment. En France, la rage est surtout surveillée chez les chiroptères. Toute exposition suspecte — comme une morsure ou un contact direct — doit conduire à une consultation urgente dans un centre antirabique , rappelle l’Institut Pasteur. Cependant, dans les zones tropicales ou en développement, les chiens restent le principal vecteur, responsables de plus de 95 % des transmissions humaines.
Quels sont ses symptômes ?
Les premiers signes de la rage sont souvent trompeurs : fièvre, maux de tête, fatigue, douleurs au site de la morsure. Puis viennent les manifestations neurologiques : anxiété, confusion, hallucinations, hypersalivation. L’un des symptômes les plus marquants est l’hydrophobie — une peur intense de l’eau, due à des spasmes douloureux du larynx à l’approche de tout liquide. Voir un patient refuser de boire, même s’il est déshydraté, c’est glaçant. C’est un signe quasi pathognomonique de la rage , témoigne une infirmière du service des maladies infectieuses, qui préfère rester anonyme.
Une fois ces symptômes présents, le pronostic est désespéré. Il n’existe aucun traitement curatif. La mort survient inévitablement, en quelques jours. Seuls quelques cas de survie ont été documentés, comme celui de l’adolescente Jeanna Giese aux États-Unis en 2004, grâce à une protocole expérimental appelé protocole Milwaukee. Mais ces exceptions restent rarissimes et ne peuvent être généralisées.
Faut-il s’inquiéter d’une propagation ?
Non, rassure Hervé Bourhy. La rage ne se transmet pas d’humain à humain par voie aérienne ou par contact social. Le risque de contamination entre personnes est quasi nul, sauf en cas de contact direct avec la salive d’un patient en phase symptomatique, notamment via des lésions cutanées ou des muqueuses. Par mesure de précaution, une dizaine de soignants ayant été en contact étroit avec Théo ont reçu un traitement post-exposition, incluant vaccination et immunoglobulines antirabiques.
Ce protocole est standard dans ce type de situation. Il n’y a pas de danger pour la population générale , insiste le Dr Cornanglia. La vigilance concerne surtout les professionnels de santé, les vétérinaires, les éleveurs, et les voyageurs se rendant dans des zones à risque.
Des traitements existent-ils ?
Oui, mais uniquement en amont de l’apparition des symptômes. Le traitement post-exposition est hautement efficace s’il est administré rapidement. Il repose sur deux piliers : le nettoyage immédiat et rigoureux de la plaie à l’eau et au savon pendant 15 minutes, suivi d’une antisepsie, puis la vaccination antirabique. Ce nettoyage mécanique élimine jusqu’à 90 % du virus , souligne Bourhy.
Pour les expositions sévères — morsures multiples, morsures au visage ou aux mains — une sérothérapie est ajoutée : injection d’immunoglobulines antirabiques autour de la plaie. Le vaccin, quant à lui, est administré en quatre ou cinq doses sur un mois. Si ce protocole est suivi dans les 24 à 48 heures suivant l’exposition, la protection est quasi totale , affirme-t-il.
Le problème, c’est que trop de voyageurs ignorent ces recommandations. Beaucoup pensent que la rage, c’est du folklore. Ou ils minimisent l’incident : “Ce n’était qu’une petite griffure.” Or, le moindre contact avec un animal suspect doit déclencher une alerte , regrette le Dr Cornanglia.
À quand remontent les précédents décès en France ?
Le cas de Théo Léger n’est malheureusement pas isolé. Début 2025, un homme est décédé à Avignon après un séjour au Maghreb, là aussi suite à une morsure de chien. En 2023, une femme originaire de Reims est morte de la rage après avoir été griffée par un chat sauvage lors d’un voyage en Afrique de l’Ouest. Ces cas, bien que rares, illustrent un schéma récurrent : voyage dans une zone endémique, exposition négligée, incubation longue, puis déclaration brutale de la maladie.
En 2023, plus de 3 000 personnes ont reçu un traitement préventif en France après une exposition à risque. 70 % d’entre elles étaient des voyageurs rentrés de l’étranger. Ce chiffre montre que le risque existe, et qu’il faut mieux informer , plaide Hervé Bourhy. Des campagnes de sensibilisation sont en cours, notamment auprès des agences de voyage et des centres de vaccination internationale.
Conclusion
La mort de Théo Léger à Perpignan est un rappel tragique de la persistance d’une maladie que l’on croyait révolue. Elle interroge sur notre niveau de vigilance face aux risques sanitaires liés aux voyages, sur l’importance d’un diagnostic précoce, et sur la nécessité de renforcer l’information des citoyens. Si la rage est rare en France, elle tue encore 59 000 personnes par an dans le monde, principalement en Afrique et en Asie. Chaque décès sur notre sol est un signal d’alarme : la prévention, rapide et rigoureuse, reste le seul rempart efficace.
A retenir
Quelle est la principale source de contamination de la rage en France ?
En France, la rage canine est éradiquée. Les cas de rage sont des importations, généralement liées à des voyages dans des zones endémiques comme le Maghreb, l’Afrique subsaharienne ou l’Asie. Les chiens restent le principal vecteur mondial.
Peut-on guérir de la rage une fois les symptômes apparus ?
Non. Une fois les symptômes neurologiques présents, la maladie est presque toujours fatale. Seuls quelques cas de survie exceptionnels ont été rapportés, grâce à des protocoles expérimentaux. La clé est l’intervention avant l’apparition des signes cliniques.
Que faire en cas de morsure ou de griffure par un animal suspect à l’étranger ?
Il faut immédiatement nettoyer la plaie à l’eau et au savon pendant 15 minutes, puis consulter un médecin ou un centre antirabique sans délai. Même si l’animal semble sain, toute exposition doit être prise au sérieux. Le traitement post-exposition est très efficace s’il est commencé rapidement.
Qui doit se faire vacciner contre la rage en prévention ?
Les voyageurs se rendant dans des zones à risque, les vétérinaires, les manipulateurs d’animaux sauvages, et les personnels travaillant sur des lyssavirus en laboratoire. La vaccination préventive consiste en trois injections et permet une protection durable.
La rage peut-elle se transmettre d’une personne à une autre ?
Exceptionnellement, par contact avec la salive d’un patient en phase symptomatique, mais jamais par voie aérienne ou contact social. Il n’y a donc pas de risque épidémique en cas de décès par rage. Les mesures de précaution concernent uniquement les soignants exposés.