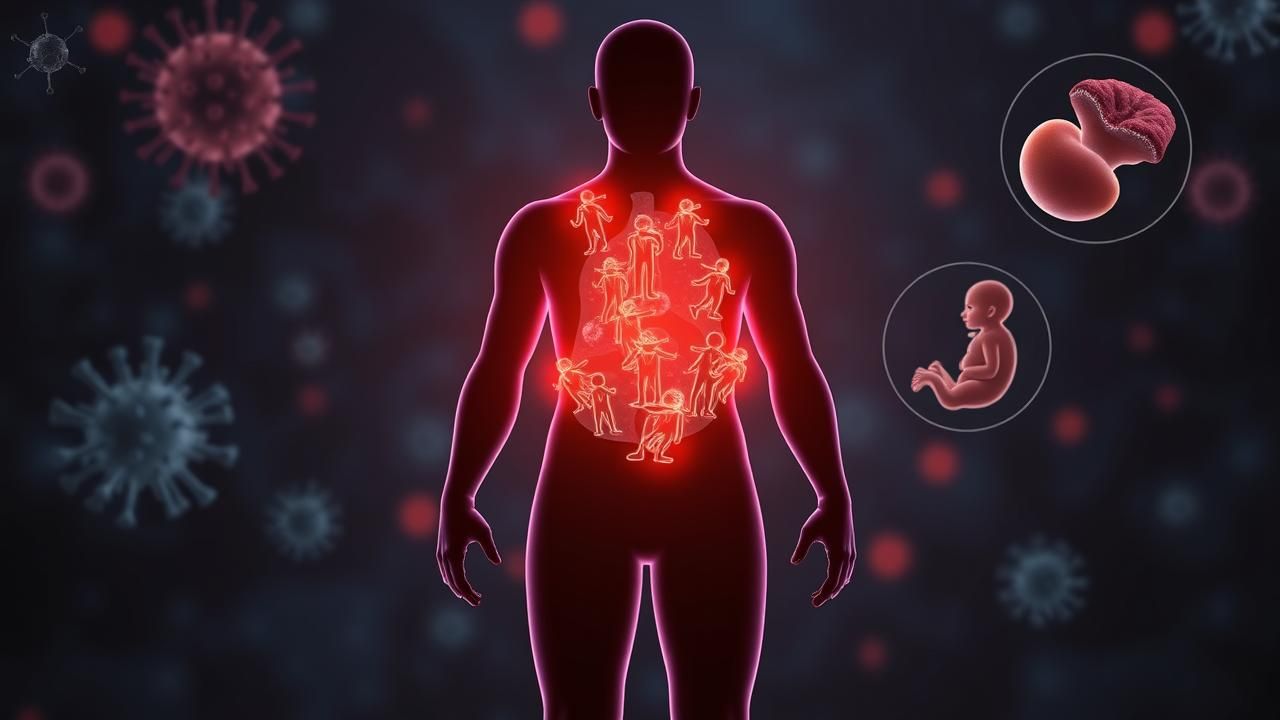En octobre 2025, l’Institut Karolinska de Stockholm a inscrit une nouvelle page dans l’histoire de la médecine en couronnant trois chercheurs d’exception du prix Nobel de physiologie ou de médecine. Shimon Sakagushi, Mary E. Brunkow et Fred Ramshdell ont été récompensés pour leurs travaux fondateurs sur la tolérance immunitaire périphérique, un mécanisme complexe mais essentiel qui permet à notre système immunitaire de distinguer le soi du non-soi. Cette découverte, longtemps méconnue du grand public, s’avère aujourd’hui cruciale pour comprendre des pathologies aussi diverses que le diabète de type 1, les cancers ou encore les maladies inflammatoires chroniques. Derrière ce concept scientifique aux allures d’énigme, se cache une révolution médicale en marche.
Qu’est-ce que la tolérance immunitaire périphérique ?
Le système immunitaire est une armée invisible, en perpétuelle alerte, chargée de repousser les envahisseurs : virus, bactéries, parasites. Mais cette armée risquerait de se retourner contre elle-même si elle n’était pas dotée d’un système de contrôle interne. C’est précisément ce que décrit la tolérance immunitaire périphérique : un ensemble de mécanismes qui empêchent les cellules immunitaires de s’attaquer aux tissus sains de l’organisme, au microbiote intestinal ou même au fœtus pendant la grossesse.
Shimon Sakagushi, immunologiste japonais formé à Kyoto avant de poursuivre ses recherches à Boston, a été l’un des premiers à identifier les cellules T régulatrices (Treg) comme actrices centrales de ce phénomène. Sans ces cellules, notre corps deviendrait un champ de bataille permanent , explique-t-il dans une interview accordée au *Journal of Immunological Advances*. Grâce à ses travaux, on comprend désormais que les Treg agissent comme des médiateurs diplomatiques au sein du système immunitaire : elles désamorcent les conflits, empêchent les surréactions et maintiennent la paix interne.
Comment ces découvertes ont-elles été faites ?
Le chemin vers cette reconnaissance internationale a été long et parsemé d’obstacles. Au début des années 1990, Fred Ramshdell, alors chercheur à Seattle, travaillait sur des souris présentant des anomalies auto-immunes. Il remarqua que certaines lignées développaient des maladies dévastatrices dès lors que les cellules T régulatrices étaient absentes. C’était comme si on retirait les freins d’une voiture lancée à pleine vitesse , confie-t-il lors d’un colloque à l’Université de Washington. Cette observation a ouvert une voie nouvelle : celle de l’identification génétique et moléculaire des Treg.
Parallèlement, Mary E. Brunkow, spécialiste de génétique moléculaire à l’Institut de recherche de Denver, a isolé le gène FOXP3, un régulateur clé de la fonction des cellules T régulatrices. Une mutation de ce gène, a-t-elle démontré, entraîne une maladie rare mais fatale appelée IPEX (syndrome d’immunodysrégulation, polyendocrinopathie, entéropathie, liée à l’X), où les patients subissent des attaques auto-immunes massives. FOXP3 est le chef d’orchestre des Treg , souligne-t-elle. Sans lui, le système immunitaire perd tout sens de la mesure.
Quel impact sur les maladies auto-immunes ?
Les maladies auto-immunes touchent des millions de personnes dans le monde. Le diabète de type 1, l’arthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques ou encore la maladie de Crohn sont autant de manifestations d’un système immunitaire qui s’emballe. La découverte de la tolérance immunitaire périphérique offre désormais une piste thérapeutique concrète.
À Lyon, le docteur Camille Leblanc, spécialiste en rhumatologie, suit depuis dix ans une patiente, Hélène Vasseur, atteinte d’une forme sévère de lupus érythémateux disséminé. Avant, on se contentait de supprimer le système immunitaire avec des corticoïdes. C’était comme éteindre un incendie avec un extincteur à mousse, au risque de tout carboniser , raconte-t-elle. Aujourd’hui, grâce aux protocoles inspirés des travaux des lauréats, elle administre à Hélène des thérapies ciblées visant à renforcer l’activité des cellules T régulatrices. Je ne suis pas guérie, mais je vis. Je travaille, je vois mes petits-enfants grandir. C’est une révolution pour moi , témoigne Hélène, les yeux humides.
Et dans la lutte contre le cancer ?
Le paradoxe du cancer est que, bien souvent, le système immunitaire le reconnaît, mais ne l’attaque pas. Pourquoi ? Parce que les tumeurs exploitent justement les mécanismes de tolérance immunitaire pour échapper à la destruction. Les cellules cancéreuses recrutent des Treg pour créer un environnement immunosuppressif autour de la tumeur.
C’est ici que les travaux des trois Nobel prennent tout leur sens. Comprendre la tolérance, c’est aussi apprendre à la contourner stratégiquement , affirme le professeur Julien Mercier, oncologue à l’hôpital Cochin à Paris. Il suit un essai clinique utilisant des anticorps capables de bloquer temporairement l’action des Treg dans les tumeurs du poumon. On libère les cellules T effectrices, on relance l’attaque immunitaire. Les résultats sont prometteurs : 40 % des patients montrent une régression significative de la tumeur.
Léa Dubois, 52 ans, mère de deux enfants et ancienne enseignante, a participé à cet essai après un diagnostic de cancer du poumon métastatique. On m’avait dit que je n’avais plus que quelques mois. Aujourd’hui, je suis en rémission partielle depuis deux ans. Je ne sais pas si je serai guérie, mais je sais que je dois ces mois supplémentaires à la science.
Quels sont les enjeux éthiques et pratiques de ces découvertes ?
Manipuler la tolérance immunitaire, c’est jouer avec le feu. Trop de suppression, et on risque des auto-immunités. Trop de stimulation, et on peut favoriser des rejets ou des inflammations incontrôlables. Le défi actuel est d’atteindre un équilibre fin, une régulation sur-mesure.
Le laboratoire de Shimon Sakagushi à Tokyo travaille aujourd’hui sur des thérapies cellulaires personnalisées : isoler les Treg d’un patient, les amplifier en laboratoire, puis les réinjecter pour restaurer la tolérance. Ce n’est pas de la science-fiction, c’est déjà en phase clinique , précise-t-il. Mais le coût reste élevé : près de 200 000 euros par traitement. L’accès équitable à ces thérapies est une priorité , insiste Mary E. Brunkow, qui milite pour des financements publics dans la recherche translationnelle.
Quid des greffes d’organes ?
Les greffes restent compromises par le risque de rejet, malgré les immunosuppresseurs lourds. Ces derniers affaiblissent tout le système immunitaire, rendant les patients vulnérables aux infections. La tolérance immunitaire périphérique ouvre la voie à une greffe sans traitement à vie.
À Montréal, le chirurgien Xavier Laroche a récemment pratiqué une greffe du rein sur un patient, Thomas Beaulieu, en combinant la transplantation avec une injection de Treg modifiées. Le but est d’induire une tolérance spécifique à l’organe greffé, sans compromettre la défense contre les infections , explique-t-il. Six mois après l’intervention, Thomas n’a pas eu besoin de corticoïdes ni d’immunosuppresseurs majeurs. Je me sens comme une personne normale. Je cours, je voyage, je travaille. Je n’ai plus l’impression d’être un malade chronique.
Quelles perspectives pour l’avenir ?
Les travaux des trois lauréats ont ouvert un champ immense de recherches. On étudie aujourd’hui la possibilité d’utiliser les Treg dans la prévention des maladies allergiques, dans les troubles psychiatriques liés à l’inflammation, voire dans le vieillissement. Le système immunitaire est impliqué dans presque tous les processus biologiques , rappelle Fred Ramshdell. Comprendre la tolérance, c’est comprendre un peu mieux la vie elle-même.
Des équipes en Allemagne et en Australie testent des thérapies géniques visant à corriger les mutations de FOXP3 chez les nouveau-nés atteints du syndrome IPEX. On parle de guérison potentielle, pas seulement de traitement , souligne la généticienne Anja Vogel, de l’Université de Heidelberg. C’est une étape que nous n’aurions pas osé imaginer il y a vingt ans.
Comment ces découvertes ont-elles été perçues dans la communauté scientifique ?
La communauté immunologique a salué une reconnaissance attendue. Sakagushi, Brunkow et Ramshdell ont changé notre regard sur l’immunité , affirme le professeur Émilien Thibault, président de la Société française d’immunologie. Avant, on pensait que le système immunitaire était un système de défense. Aujourd’hui, on sait qu’il est aussi un système de régulation, de paix.
Le prix Nobel n’est pas seulement une récompense, c’est aussi un levier. Il attire les financements, motive les jeunes chercheurs, et donne de la visibilité à des domaines encore mal compris. Quand j’ai commencé, on me disait que les Treg étaient une curiosité de laboratoire , se souvient Shimon Sakagushi. Aujourd’hui, elles sont au cœur de la médecine du futur.
A retenir
Qu’est-ce que la tolérance immunitaire périphérique ?
Il s’agit d’un mécanisme biologique permettant au système immunitaire de ne pas attaquer les cellules saines de l’organisme, le microbiote ou le fœtus. Elle repose notamment sur l’action des cellules T régulatrices (Treg), découvertes et caractérisées par les lauréats du prix Nobel 2025.
Quel lien avec les maladies auto-immunes ?
Un dysfonctionnement de la tolérance immunitaire peut entraîner des attaques du système immunitaire contre les tissus propres, conduisant à des maladies comme le diabète de type 1, l’arthrite rhumatoïde ou le lupus. Les thérapies visant à restaurer l’activité des Treg offrent de nouvelles perspectives de traitement.
Comment ces découvertes aident-elles dans la lutte contre le cancer ?
Les tumeurs utilisent la tolérance immunitaire pour échapper à la surveillance. En ciblant ou en bloquant temporairement les Treg dans l’environnement tumoral, il devient possible de relancer l’attaque immunitaire contre le cancer, comme le montrent les thérapies par immunomodulation.
Quelles applications dans les greffes d’organes ?
Les recherches visent à induire une tolérance spécifique à l’organe greffé, permettant de réduire, voire d’éliminer, la nécessité de traitements immunosuppresseurs à vie. Des essais combinant greffes et transferts de Treg montrent des résultats encourageants.
Quels sont les défis restants ?
Les principaux défis sont la personnalisation des traitements, le contrôle fin des mécanismes de tolérance pour éviter les effets secondaires, et l’accès équitable à ces thérapies innovantes, souvent coûteuses. La recherche continue à explorer des pistes géniques, cellulaires et pharmacologiques pour surmonter ces obstacles.