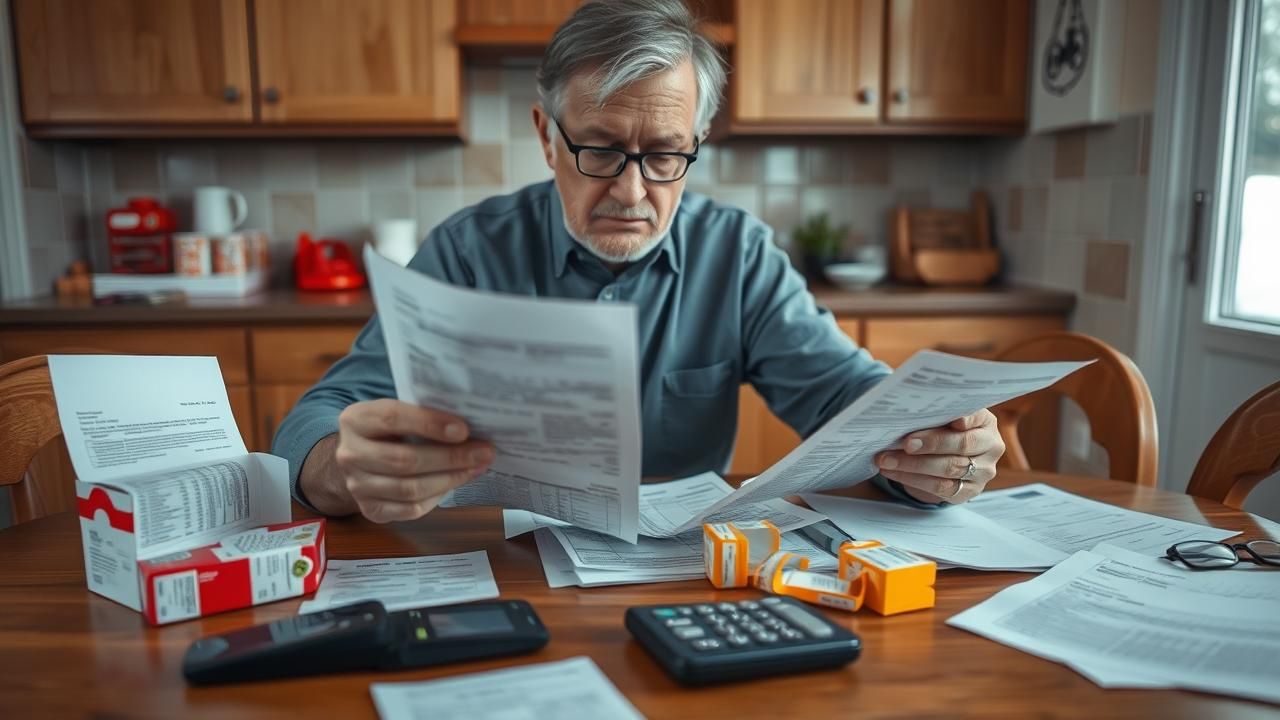En 2024, les Français ont consacré plus que jamais une part croissante de leur budget aux soins et biens médicaux, avec des dépenses totales atteignant 255 milliards d’euros, soit 3 723 euros par habitant. Ce chiffre, dévoilé par le rapport annuel de la Drees publié le 30 septembre 2025, témoigne d’une pression durable sur le système de santé, amplifiée par des mesures de réforme ayant accru la participation financière des patients. Alors que la crise sanitaire a laissé des traces durables dans les comportements de consommation de soins, une nouvelle donne s’impose : le reste à charge pour les ménages progresse légèrement, dépassant désormais 292 euros par an. Derrière ces chiffres, des réalités humaines, des ajustements quotidiens, et des questionnements sur l’équité d’un système censé garantir l’accès aux soins pour tous.
Qu’est-ce que la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) ?
La CSBM englobe l’essentiel des dépenses directement liées à la santé : les honoraires des médecins, dentistes et auxiliaires médicaux, les médicaments, les dispositifs médicaux, les analyses en laboratoire, les transports sanitaires, ainsi que les soins prodigués à l’hôpital ou en cabinet. En revanche, elle exclut les soins de longue durée, comme ceux dispensés en Ehpad, ou les actions de prévention, qui relèvent d’autres logiques de financement. En 2024, cette enveloppe s’est accrue de 3,7 %, un rythme moindre qu’en 2023 (+4,8 %), mais supérieur à la moyenne observée entre 2010 et 2019, où la croissance annuelle tournait autour de 2 %. Cette tendance reflète une inflation structurelle dans le secteur médical, portée par des facteurs variés : vieillissement de la population, recours accru aux traitements innovants, et hausse des prix unitaires.
Pourquoi les dépenses de santé augmentent-elles malgré les réformes ?
L’augmentation des dépenses s’inscrit dans un contexte de réformes budgétaires visant à maîtriser les coûts à long terme. Pourtant, les effets escomptés semblent contrecarrés par des dynamiques contraires. Le rapport de la Drees pointe notamment une accélération de la consommation de médicaments, en hausse de 5,5 %, tirée non pas par une augmentation massive du nombre de boîtes vendues (+0,9 %), mais par le recours croissant à des traitements innovants, souvent très coûteux. Ces médicaments, destinés à des maladies complexes comme le cancer ou les maladies rares, représentent une avancée thérapeutique majeure, mais leur prix pèse lourdement sur la CSBM.
Le docteur Élodie Renard, généraliste à Rennes, observe une transformation dans la manière dont les patients abordent leur traitement : Il y a dix ans, on prescrivait surtout des médicaments génériques ou des molécules matures. Aujourd’hui, les nouvelles molécules arrivent plus vite sur le marché, et les patients en demandent, parfois parce qu’ils ont vu des publicités ou des témoignages en ligne. Mais quand ils reçoivent la boîte, certains sont choqués par le reste à charge, même si une partie est remboursée.
Comment évolue la répartition du financement des soins ?
En 2024, la Sécurité sociale et l’État couvrent 79,4 % des dépenses, soit 202 milliards d’euros, une part en recul de 0,5 point par rapport à l’année précédente. À l’inverse, les organismes complémentaires (mutuelles, assurances) voient leur contribution croître de 0,3 point, atteignant 12,8 % du total, soit 33 milliards d’euros. Quant à la part directement assumée par les ménages, elle progresse légèrement, passant à 7,8 %, contre 7,7 % en 2023.
Cette évolution traduit une transformation silencieuse du modèle : les patients supportent davantage de frais directement, notamment à travers les franchises et participations forfaitaires. Le doublement de ces franchises a un effet dissuasif, reconnaît Camille Lefebvre, économiste à la Drees. Pour des soins non urgents, certains patients hésitent, voire renoncent. C’est une tendance que nous surveillons de près.
Quel est l’impact du reste à charge sur les ménages ?
Le reste à charge moyen s’élève désormais à 292 euros par an, contre 276 euros en 2023. Cette hausse, bien que modeste en apparence, pèse particulièrement sur les foyers à revenus modestes ou ceux confrontés à des pathologies chroniques. Pour exemple, un traitement contre une maladie auto-immune peut coûter plusieurs milliers d’euros par an, et même avec une couverture par la Sécurité sociale et la mutuelle, le patient peut devoir débourser plusieurs centaines d’euros mensuels.
Je prends un traitement biologique depuis trois ans, témoigne Thomas Vasseur, 48 ans, professeur de musique à Lyon. Ma mutuelle couvre bien, mais il reste toujours 40 à 50 euros par mois. Ce n’est pas énorme, mais quand on additionne les consultations, les examens, et que mon fils a besoin de lunettes, ça fait mal.
Ce phénomène de cumul des frais inquiète les associations de patients. Le reste à charge n’est jamais isolé, souligne Bénédicte Kessler, porte-parole de l’association Santé Pour Tous. Il s’ajoute aux autres dépenses de santé : orthodontie pour les enfants, appareils auditifs, soins dentaires. Pour certains, cela représente un véritable gouffre.
Pourquoi les soins de ville augmentent-ils plus vite que les soins hospitaliers ?
En 2024, les dépenses liées aux soins de ville (médecins, pharmacies, kinésithérapeutes, etc.) ont progressé de 4 %, contre +2,9 % pour les soins hospitaliers. Cette divergence s’explique par plusieurs facteurs : une meilleure prise en charge à l’hôpital grâce à des contrats pluriannuels de performance, mais aussi une médicalisation croissante en dehors des établissements. Les Français consultent davantage en ville, parfois par manque de places à l’hôpital, parfois par préférence.
Le docteur Renard confirme : On voit arriver des patients qu’on aurait envoyés à l’hôpital il y a dix ans, mais aujourd’hui, faute de disponibilité, on les suit en cabinet, avec des examens parfois répétés. Cela augmente la charge, mais aussi le risque de fragmentation des soins.
Par ailleurs, la montée en puissance des soins paramédicaux (ostéopathie, sophrologie, etc.), souvent partiellement remboursés, contribue à cette inflation. Ma mutuelle ne rembourse que 15 séances d’ostéopathie par an, alors que j’en ai besoin tous les deux mois, raconte Lucie Ménard, 35 ans, enseignante à Bordeaux. Le reste, c’est à moi de le payer.
Quelles sont les conséquences du doublement des franchises médicales ?
Le doublement des franchises médicales, entré en vigueur en 2024, a eu un impact direct sur le porte-monnaie des patients. Ces franchises, qui s’appliquent notamment aux consultations, aux transports sanitaires et aux médicaments, visent à limiter les abus et responsabiliser les usagers. Mais selon plusieurs experts, leur effet dissuasif pourrait nuire à l’accès aux soins.
On voit des patients retarder leurs consultations, parfois de plusieurs mois, note le docteur Renard. Ils attendent que les symptômes s’aggravent, et là, ils finissent par venir en urgence. C’est exactement l’inverse de ce qu’on cherche à faire.
Le cas de Jérôme Aubin, 62 ans, retraité à Marseille, illustre ce phénomène : J’ai eu une douleur au dos pendant des semaines. Je savais que je devais voir un rhumatologue, mais entre la franchise de consultation, les radios, et le kiné, je me suis dit que je pouvais attendre. Puis j’ai eu une crise, et là, c’était l’urgence. Depuis, je me demande si j’aurais dû venir plus tôt.
La part des dépenses dans le PIB est-elle préoccupante ?
En 2024, les dépenses de santé représentent 8,7 % du PIB, un niveau stable par rapport aux années précédentes. Ce chiffre, bien qu’important, est dans la moyenne des pays développés. Toutefois, sa pérennité dépend de la capacité du système à maintenir l’équilibre entre qualité des soins, accessibilité et maîtrise des coûts.
L’enjeu n’est pas tant le pourcentage du PIB que la manière dont cet argent est utilisé, analyse Camille Lefebvre. Est-ce qu’on investit dans la prévention ? Est-ce qu’on réduit les inégalités d’accès ? Ce sont ces questions qui comptent.
Quelles solutions pour limiter la hausse du reste à charge ?
Plusieurs pistes sont envisagées : une meilleure négociation des prix des médicaments innovants, un renforcement des politiques de prévention, ou encore une révision des franchises pour les patients vulnérables. Certaines voix appellent à une modulation des franchises selon le revenu ou l’état de santé, afin d’éviter que les plus fragiles ne soient pénalisés.
On ne peut pas appliquer les mêmes règles à un cadre de 40 ans en bonne santé et à une personne de 70 ans avec trois maladies chroniques , insiste Bénédicte Kessler.
Des expérimentations sont déjà menées dans certaines régions, comme en Nouvelle-Aquitaine, où des mutuelles locales proposent des forfaits de soins annuels, plafonnant le reste à charge. Cela rassure les patients, et cela encourage les visites de prévention , constate le docteur Renard.
Conclusion
La santé reste un pilier fondamental de la protection sociale française, mais elle fait face à des tensions croissantes. L’augmentation des dépenses, portée par des innovations coûteuses et un vieillissement de la population, s’accompagne d’un relèvement progressif du reste à charge pour les ménages. Si les réformes visent à responsabiliser les patients, elles doivent aussi garantir que personne ne renonce à se soigner par crainte des coûts. L’avenir du système dépendra de sa capacité à concilier innovation, équité et maîtrise des dépenses.
A retenir
Quelle est la dépense moyenne par habitant en 2024 ?
Les dépenses de soins et biens médicaux s’élèvent à 3 723 euros par habitant en 2024, pour un total de 255 milliards d’euros.
Le reste à charge a-t-il augmenté ?
Oui, il passe de 276 euros en 2023 à 292 euros en 2024, en raison notamment du doublement des franchises médicales et de la baisse de remboursement de certains soins.
Qui finance principalement les soins en France ?
La Sécurité sociale et l’État couvrent 79,4 % des dépenses, les organismes complémentaires 12,8 %, et les ménages directement 7,8 %.
Pourquoi les médicaments coûtent-ils plus cher ?
La hausse des dépenses en médicaments (+5,5 %) est principalement due à la consommation croissante de traitements innovants, souvent très coûteux, même si le nombre de boîtes vendues augmente peu.
Les soins hospitaliers augmentent-ils moins vite que les soins en ville ?
Oui, les soins hospitaliers progressent de 2,9 % contre 4 % pour les soins de ville, en raison de contrats de performance à l’hôpital et d’une médicalisation accrue en secteur ambulatoire.