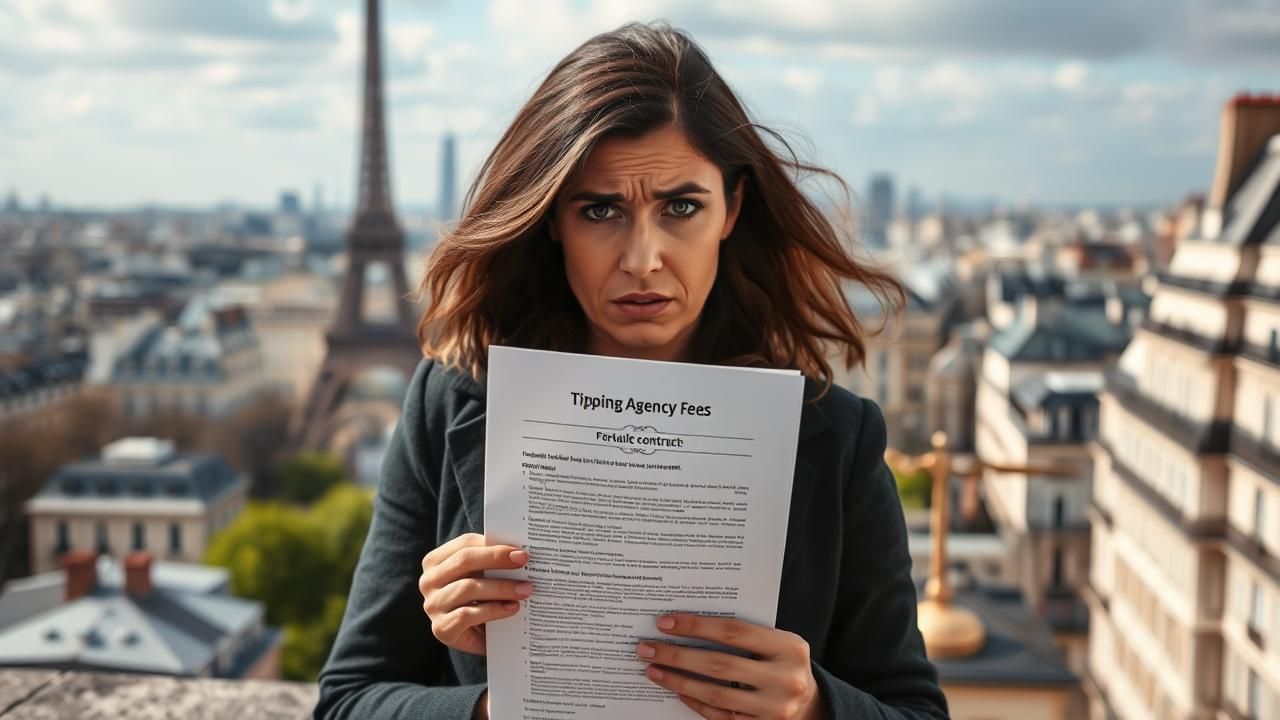À partir du 1er janvier 2026, les frais d’agence pour les locations en France vont connaître une évolution inédite depuis 2014. Cette décision, longtemps réclamée par les professionnels du secteur, s’inscrit dans un contexte de tension persistante sur le marché locatif. Si la hausse reste modeste et conditionnée à l’évolution des loyers, elle soulève des interrogations sur son impact concret pour les locataires et les propriétaires. Pour mieux comprendre cette réforme, analysons ses enjeux, les motivations des acteurs concernés et les scénarios possibles.
Quels frais peuvent légalement être facturés à un locataire lors d’une location via une agence ?
Depuis 2014, la loi Alur encadre strictement les frais imputables aux locataires. Ces coûts se limitent à trois postes précis : la visite du logement, la constitution du dossier et la rédaction du bail. Chaque agence doit respecter des plafonds fixés selon la localisation du bien. Par exemple, à Paris, les frais d’agence ne peuvent excéder 15 € TTC/m² pour ces trois services combinés, contre 12 € à Lyon et 8 € en province. Ces tarifs, inchangés depuis onze ans, ont été critiqués par les syndicats professionnels pour leur inadéquation avec l’inflation.
Le cas de Sophie Leroy, locataire à Bordeaux, illustre ces contraintes. « Lors de mon dernier déménagement, j’ai payé 350 € de frais d’agence pour un studio de 28 m². C’était lourd, mais j’ai compris : l’agence avait organisé plusieurs visites, vérifié mes garanties et passé du temps à établir le contrat. » Toutefois, Sophie souligne que d’autres dépenses, comme l’état des lieux, viennent s’ajouter à ce montant initial.
Pourquoi les plafonds des frais d’agence n’ont-ils pas évolué depuis 2014 ?
Le décret de 2014 prévoyait une révision annuelle des plafonds, indexée sur l’indice de référence des loyers (IRL). Pourtant, cette clause est restée lettre morte. « L’État n’avait aucune obligation légale de l’appliquer », explique Jean-Paul Renaud, juriste spécialisé en droit immobilier. « Les syndicats comme la FNAIM ou l’Unis ont multiplié les démarches, mais les tribunaux ont toujours rejeté leurs demandes d’ajustement automatique. »
Cette stagnation a creusé un écart grandissant entre les coûts réels des services et les tarifs autorisés. Selon une étude du SNPI publiée en 2023, le coût moyen d’une gestion locative a augmenté de 22 % depuis 2014, notamment à cause de la digitalisation des démarches et des charges salariales. « Nous devons utiliser des outils de gestion informatisés, embaucher des juristes pour les baux complexes… Les frais plafonnés ne couvrent plus ces investissements », déplore Danielle Dubrac, présidente de l’Unis.
Comment l’arrêté de 2026 va-t-il modifier cette situation ?
Le texte publié par le ministère de l’Aménagement du territoire prévoit une revalorisation unique au 1er janvier 2026, basée sur l’évolution de l’IRL entre le troisième trimestre 2024 et 2025. « Si l’indice augmente de 3 %, les plafonds suivront cette proportion », précise Éric Vidal, porte-parole du ministère. « Mais en cas de baisse ou de stagnation, rien ne changera. »
Cette approche prudente divise les acteurs du secteur. Marc Moreau, propriétaire bailleur à Marseille, s’en réjouit : « J’espère que cette hausse permettra aux agences de mieux rémunérer leurs agents. Trop souvent, les locataires se plaignent de la qualité du service après la signature du bail. » En revanche, pour Léa Nguyen, étudiante locataire à Lille, la perspective d’une augmentation reste inquiétante : « Mon budget est déjà serré. Chaque euro de plus me contraindra à réduire mes dépenses alimentaires ou culturelles. »
Quel impact cette réforme aura-t-elle sur le marché locatif ?
Pour les agences, cette évolution pourrait renforcer leur attractivité auprès des propriétaires. « Beaucoup préfèrent gérer leurs locations en direct pour éviter de payer les frais plafonnés », note Caroline Dubois, directrice d’une agence parisienne. « Avec une revalorisation, nous pourrons proposer des services plus complets, comme des diagnostics énergétiques ou des conseils fiscaux, sans surcharger les locataires. »
Cependant, les tenants du secteur privé craignent que cette hausse n’accentue les tensions. « Les plafonds restent bien en-deçà de nos demandes initiales », insiste Danielle Dubrac. « Nous espérions une revalorisation annuelle automatique, pas une révision ponctuelle. » Selon elle, une évolution trop timide pourrait pousser certaines agences à contourner la réglementation en facturant des « frais annexes » non encadrés.
Quels sont les arguments des professionnels en faveur d’une réforme plus profonde ?
Les syndicats du logement pointent plusieurs lacunes dans le système actuel. D’abord, l’absence de révision automatique crée une insécurité juridique. Ensuite, les plafonds ne prennent pas en compte les spécificités des marchés locaux. « À Strasbourg, où la demande excède l’offre de 40 %, les agences doivent mobiliser davantage de ressources pour trouver des locataires fiables », souligne Jean-Paul Renaud.
Le débat s’étend aussi aux charges non réglementées. « L’état des lieux, plafonné à 3 € TTC/m², ne couvre plus le coût réel des interventions », affirme Caroline Dubois. « Nous devons parfois faire appel à des photographes professionnels pour documenter l’état du logement, surtout en cas de litige. » Selon une enquête du SNPI, 60 % des agences facturent désormais ces prestations en supplément, malgré les interdictions légales.
Comment les locataires perçoivent-ils ces évolutions ?
Les réactions sont mitigées. Pour les jeunes actifs comme Sophie Leroy, la transparence des frais est un progrès. « Savoir que l’agence ne peut pas me demander plus de 15 €/m² à Paris me rassure. Mais si cette somme augmente, je devrais peut-être privilégier les locations en direct. »
En revanche, les ménages modestes redoutent l’impact cumulé des hausses. « J’ai déjà du mal à réunir la caution et les premiers loyers », confie Léa Nguyen. « Une agence m’a même proposé de payer les frais en plusieurs fois, mais avec des frais de dossier supplémentaires. » Selon l’association Action Logement, 28 % des locataires renoncent à un logement à cause des coûts initiaux.
A retenir
Quels sont les trois postes de frais d’agence encadrés par la loi Alur ?
Les frais couvrent la visite du logement, la constitution du dossier et la rédaction du bail. Les états des lieux sont réglementés par un plafond distinct de 3 € TTC/m².
La hausse de 2026 sera-t-elle systématique ?
Non. Elle dépendra de l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL) entre 2024 et 2025. Si l’IRL baisse ou stagne, les plafonds resteront inchangés.
Pourquoi les syndicats réclament-ils une révision annuelle automatique ?
Les professionnels estiment que l’absence de mise à jour régulière fragilise leur modèle économique. « Depuis 2014, nos coûts ont augmenté de 22 %, mais nos revenus sont bloqués », explique Danielle Dubrac.
Les locataires peuvent-ils refuser de payer des frais au-delà des plafonds ?
Oui. Tout dépassement est illégal et passible d’un signalement à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Toutefois, certaines agences contourneraient cette règle en facturant des services annexes.
Quel est l’impact de cette réforme sur le marché locatif ?
Elle pourrait inciter davantage de propriétaires à passer par des agences, améliorant ainsi la qualité des services offerts. En revanche, les locataires aux revenus modestes craignent une pression supplémentaire sur leur budget.