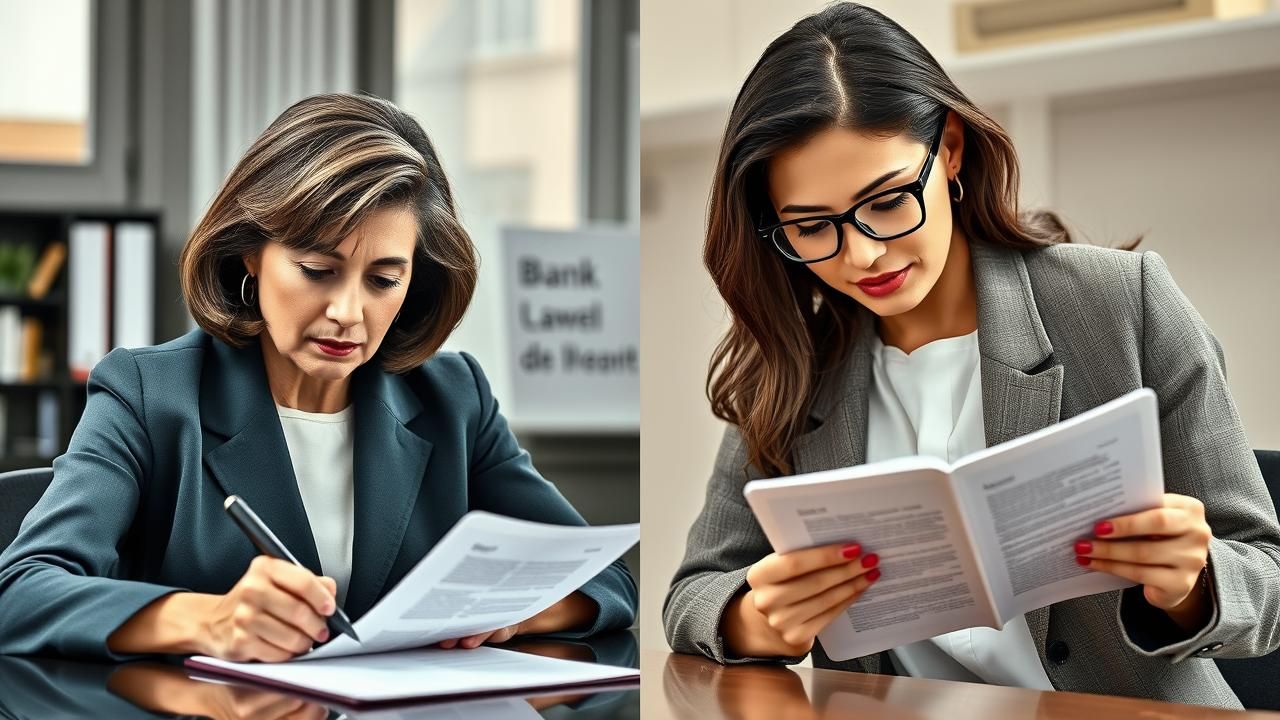En 1965, un changement discret mais profond a bouleversé la vie de millions de Françaises : la loi du 13 juillet a enfin reconnu aux femmes mariées le droit de disposer librement de leurs biens, de travailler sans l’autorisation de leur mari, et d’ouvrir un compte bancaire à leur nom. Ce texte législatif, longtemps passé sous silence, a marqué le début d’un lent mais irréversible mouvement d’émancipation économique. À l’époque, l’idée qu’une femme puisse gérer son argent seule semblait presque subversive. Aujourd’hui, ce droit fondamental paraît acquis — pourtant, son héritage reste vivant, parfois fragile, et les traces d’un passé inégalitaire persistent dans les comportements, les mentalités et même les dispositifs financiers. Comment une simple réforme a-t-elle pu transformer la place des femmes dans l’économie domestique ? Et pourquoi, près de soixante ans plus tard, certaines inégalités subsistent-elles malgré les lois ?
Quelle a été la portée réelle de la loi de 1965 ?
Avant 1965, le Code civil de 1804, héritier de l’ère napoléonienne, plaçait la femme mariée dans une situation de subordination juridique. Elle était assimilée à une mineure : pour exercer une activité professionnelle, ouvrir un compte en banque, ou même signer un contrat, elle devait obtenir l’autorisation écrite de son époux. Cette dépendance n’était pas seulement symbolique — elle avait des conséquences concrètes sur la liberté de mouvement, l’accès à l’emploi, et la capacité d’autonomie financière. La loi du 13 juillet 1965 a brisé ce cadre en instaurant le principe d’égalité dans la gestion des biens entre époux. Dorénavant, chaque conjoint pouvait agir seul dans les actes de la vie courante, et la femme mariée devenait titulaire de plein droit de ses revenus professionnels.
Cette avancée a été saluée par des figures comme Émilie Lefebvre, professeure d’histoire contemporaine à l’université de Lyon. « Cette loi n’était pas seulement juridique, elle était culturelle. Elle a permis aux femmes de sortir de l’ombre économique du foyer. Pour la première fois, elles pouvaient accumuler un patrimoine personnel, investir, ou décider seules d’un achat important. » Un témoin de cette époque, Jeanne Vidal, aujourd’hui octogénaire, se souvient : « En 1967, j’ai ouvert mon premier compte à la Banque de France. Mon mari m’a regardée comme si je faisais une bêtise. Mais ce jour-là, j’ai senti que quelque chose avait changé. J’avais un numéro de compte, un carnet de chèques, et surtout, un sentiment de liberté. »
Comment la bancarisation a-t-elle transformé les foyers français ?
La loi de 1965 n’aurait pas eu le même impact sans l’évolution parallèle des systèmes financiers. Dans les années 1960, moins d’un ménage sur cinq possédait un compte bancaire. Les salaires étaient souvent versés en espèces, et les femmes n’avaient guère d’interaction directe avec les institutions financières. Mais à partir des années 1970, la mensualisation des salaires et l’obligation de verser les rémunérations supérieures à un certain seuil sur un compte ont accéléré la bancarisation. En 1976, près de 90 % des ménages français en possédaient un.
Cette banalisation des comptes a profondément modifié les dynamiques internes des couples. Le chéquier, longtemps perçu comme un outil masculin, est devenu un vecteur d’autonomie. Pourtant, les résistances n’ont pas disparu du jour au lendemain. Certaines banques hésitaient encore à remettre un chéquier à une femme mariée, redoutant qu’elle « dilapide » l’argent du ménage. Des témoignages recueillis dans les années 1980 font état de refus d’ouverture de crédit ou de conseils paternalistes de conseillers bancaires. « On me disait : “Votre mari s’occupe de ça, non ?” », raconte Sophie Ménard, alors jeune cadre dans une entreprise lyonnaise. « J’ai dû insister pour avoir un prêt à mon nom. Aujourd’hui, c’est impensable… mais à l’époque, c’était normal. »
Quelles inégalités persistent malgré les réformes ?
Si les femmes ont acquis des droits formels, les écarts concrets en matière d’indépendance économique restent significatifs. La loi de 1986, qui a instauré la copropriété des biens acquis pendant le mariage, a été un pas en avant, mais elle n’a pas résolu les déséquilibres structurels. Aujourd’hui encore, les femmes sont moins nombreuses à investir dans des produits financiers risqués, comme les actions ou les SCPI, et reçoivent moins souvent des crédits bancaires, même lorsqu’elles ont un profil solvable.
Les raisons sont multiples. D’abord, le poids des stéréotypes : les femmes ont tendance à sous-estimer leurs compétences financières, ce que confirme une étude de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de 2023. Ensuite, la précarité de certains parcours professionnels — notamment en raison des interruptions de carrière liées à la maternité — affecte leur capacité à accumuler un patrimoine. Enfin, dans certains foyers, les revenus des femmes sont encore perçus comme un « complément » plutôt qu’une ressource principale, ce qui influence les décisions de gestion d’argent.
Camille Dubois, entrepreneuse à Bordeaux, témoigne : « J’ai monté ma société en 2019. Quand j’ai demandé un prêt, mon dossier était solide, mais j’ai senti une réticence. Le banquier m’a posé des questions sur mes enfants, mon mari… comme si ma stabilité familiale était plus pertinente que mon business plan. Un homme dans la même situation n’aurait pas eu à subir cet entretien-là. »
La loi Rixain de 2021 : une avancée contre les violences économiques ?
La loi Rixain, adoptée en 2021, s’inscrit dans la continuité de cette lutte pour l’autonomie financière. Elle oblige les employeurs et les organismes sociaux à verser salaires et prestations sur un compte dont la personne concernée est titulaire. Cette mesure vise à empêcher les situations de dépendance économique, notamment dans les cas de violences conjugales, où un conjoint peut contrôler l’accès aux ressources de l’autre.
Le dispositif a déjà eu des effets concrets. Des associations comme « Femmes Solidaires » ont observé une augmentation des demandes d’aide financière depuis son application. « Beaucoup de femmes vivaient sans compte à leur nom, sans carte bancaire, sans accès direct à leurs allocations », explique Léa Chauvet, chargée de mission dans l’association. « La loi Rixain leur a permis de rompre ce lien de dépendance. Ce n’est pas seulement une question de droits, c’est une question de sécurité. »
Pourtant, les limites de la loi sont visibles. Certaines femmes, notamment dans des zones rurales ou parmi les populations précaires, n’ont toujours pas de compte bancaire. D’autres, en situation de contrôle psychologique, hésitent à exercer leurs droits par peur des représailles. L’autonomie financière, même garantie par la loi, suppose aussi un accompagnement humain, social, et éducatif.
Quelles initiatives renforcent l’indépendance économique des femmes aujourd’hui ?
Des réponses émergent à plusieurs niveaux. Dans le secteur bancaire, certaines institutions ont lancé des programmes spécifiques : ateliers de gestion d’argent, accompagnement pour les entrepreneures, ou offres de crédit adaptées. BNP Paribas, par exemple, a mis en place un dispositif de mentorat pour les femmes créatrices d’entreprise, tandis que Crédit Agricole propose des outils numériques pour mieux suivre ses finances, avec un focus sur les besoins des femmes en transition professionnelle.
Des fonds d’investissement exclusivement dédiés aux femmes ont également vu le jour. Le fonds « HerVentures », lancé en 2022, finance uniquement des projets portés par des femmes ou des équipes mixtes avec une forte représentation féminine. « L’objectif n’est pas de faire de la discrimination positive, mais de corriger un déséquilibre historique », précise son fondatrice, Inès Rocher. « Les femmes ont des idées, des compétences, mais elles manquent souvent de levier pour les concrétiser. »
Par ailleurs, l’éducation financière gagne du terrain dans les écoles et les universités. Des associations comme « Argent et Vie » interviennent auprès des jeunes femmes pour leur apprendre à budgéter, investir, ou négocier un salaire. « On ne naît pas financièrement autonome, on le devient », résume la fondatrice, Nadia El Khatib. « Et plus tôt on commence, plus on évite les pièges. »
Que reste-t-il à faire pour une véritable égalité économique ?
Les progrès sont indéniables, mais l’égalité salariale, l’accès équitable au crédit, et la répartition des responsabilités financières au sein du couple restent des défis. En 2024, l’écart de revenus entre hommes et femmes s’élève encore à 15 % en moyenne, et les femmes consacrent en moyenne deux heures de plus par jour aux tâches domestiques — un déséquilibre qui affecte leur disponibilité pour les affaires financières.
Des experts comme le sociologue Thomas Lefort appellent à une refonte des mentalités : « Il ne suffit pas de légiférer. Il faut aussi transformer les pratiques quotidiennes. Combien de couples discutent réellement des finances à égalité ? Combien de femmes prennent seules des décisions d’investissement ? » Pour lui, la solution passe par une éducation financière mixte, dès le collège, et par des politiques de soutien à la parentalité qui ne pénalisent pas les femmes.
Le chemin est encore long, mais chaque avancée — légale, culturelle ou individuelle — compte. Comme le dit Clara Moreau, 34 ans, cadre dans une entreprise de tech : « Quand j’ai reçu mon premier salaire sur mon compte personnel, à 22 ans, je n’y ai pas pensé. Aujourd’hui, je réalise que c’est un privilège que des générations ont dû conquérir. Et je veux que mes filles n’aient jamais à se battre pour ça. »
A retenir
Quel était le statut juridique des femmes mariées avant 1965 ?
Jusqu’en 1965, les femmes mariées étaient placées sous l’autorité de leur mari en vertu du Code civil de 1804. Elles ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire, exercer une profession ou signer un contrat sans l’autorisation de leur époux, ce qui les rendait économiquement dépendantes.
Qu’a changé la loi de 1965 ?
La loi du 13 juillet 1965 a instauré l’autonomie financière des femmes mariées. Elle leur a permis de gérer leurs revenus, d’exercer une activité professionnelle librement, et d’ouvrir un compte bancaire sans accord conjugal, marquant un tournant vers l’égalité économique.
Pourquoi parle-t-on de violences économiques aujourd’hui ?
Les violences économiques désignent les situations où un conjoint contrôle l’accès à l’argent, empêche l’autre de travailler ou de disposer de ses revenus. Ces formes de domination persistent malgré les lois, d’où l’importance de mesures comme la loi Rixain de 2021.
Les femmes ont-elles aujourd’hui un accès égal au crédit ?
Non. Les femmes rencontrent encore des obstacles à l’obtention de crédits, notamment pour la création d’entreprise. Elles sont souvent perçues comme plus risquées, et leurs dossiers sont examinés avec plus de suspicion, même quand leur solvabilité est équivalente à celle des hommes.
Quelles sont les solutions pour renforcer l’autonomie financière des femmes ?
Des solutions existent à plusieurs niveaux : l’éducation financière dès le jeune âge, des fonds d’investissement dédiés, des politiques bancaires inclusives, et des lois garantissant un accès direct aux revenus. L’enjeu est autant culturel que juridique.