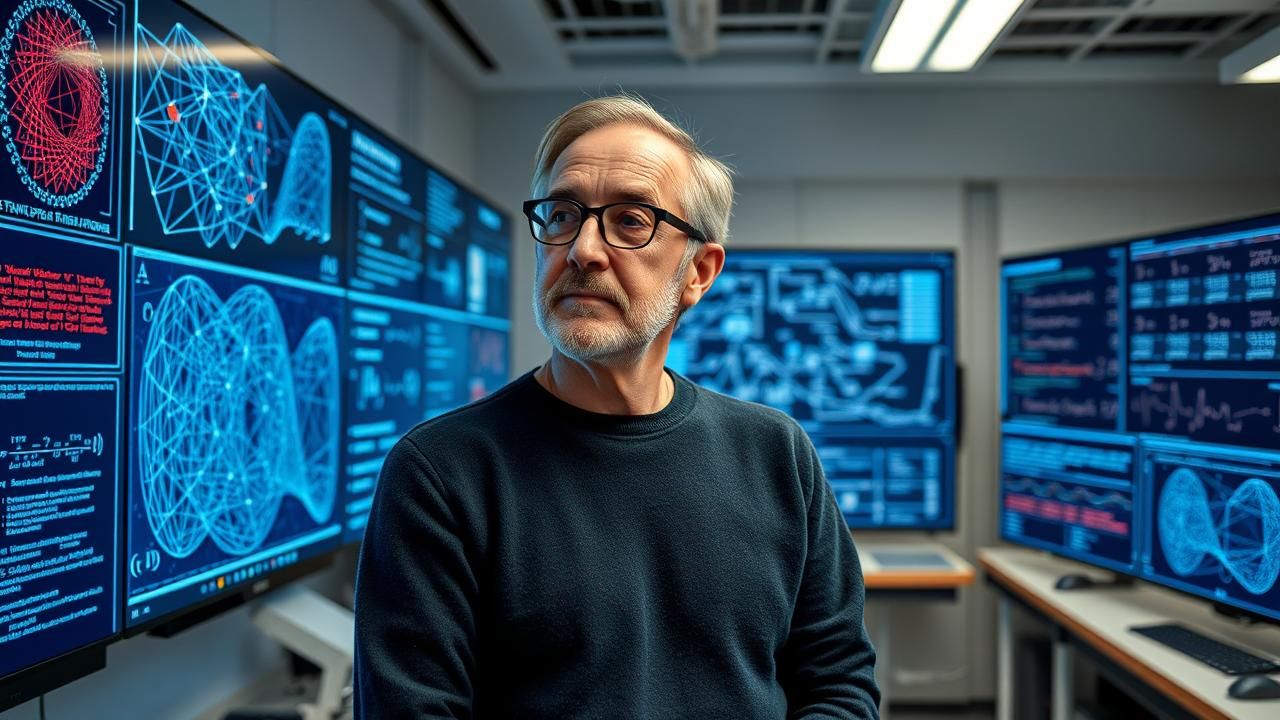En 2025, la médaille d’or du CNRS, distinction scientifique la plus prestigieuse en France, a été attribuée à Stéphane Mallat, mathématicien visionnaire dont les travaux ont profondément marqué plusieurs domaines, du traitement du signal à l’intelligence artificielle. Ce prix, rarement accordé aux mathématiques appliquées, consacre un parcours d’exception, à la croisée des disciplines, où la rigueur mathématique rencontre les enjeux concrets du monde moderne. Mallat incarne une nouvelle génération de scientifiques capables de penser au-delà des silos académiques, et son travail actuel vise rien moins que de percer les mystères des intelligences artificielles, notamment celles capables de produire du langage, de composer de la musique ou d’analyser des données complexes. Pourquoi ces machines réussissent-elles là où les théories classiques échouaient ? Comment peuvent-elles apprendre sans comprendre ? C’est à ces questions que Mallat consacre aujourd’hui son énergie, en quête d’une théorie mathématique de la connaissance elle-même.
Qu’est-ce que la médaille d’or du CNRS signifie pour un scientifique comme Stéphane Mallat ?
Recevoir la médaille d’or du CNRS, c’est entrer dans une lignée d’illustres chercheurs dont les noms résonnent dans l’histoire des sciences. Pour Stéphane Mallat, cette distinction dépasse la reconnaissance personnelle. Elle symbolise surtout la légitimité d’un domaine longtemps sous-estimé : les mathématiques appliquées. C’est la première fois que ce prix honore un chercheur dont le travail s’inscrit dans cette branche , souligne-t-il. En France, les mathématiques pures ont longtemps dominé le paysage intellectuel, tandis que les applications pratiques étaient considérées comme secondaires. Mallat bouscule cette hiérarchie en rappelant que les grandes avancées mathématiques ont souvent surgi de problèmes concrets. Quand on étudie une image floue ou un signal bruité, on ne fait pas que de l’ingénierie. On touche à des structures fondamentales , explique-t-il. C’est précisément ce pont entre le réel et l’abstrait qu’il a su construire tout au long de sa carrière.
Comment Stéphane Mallat est-il devenu un passeur entre les mathématiques et l’informatique ?
Le parcours de Mallat est celui d’un scientifique curieux, refusant de se cantonner à une seule discipline. Formé aux mathématiques pures, il s’est tourné très tôt vers des applications concrètes. À l’époque, le traitement du signal était un domaine émergent, confronté à des défis techniques majeurs : comment analyser une image sans perdre d’information ? Comment compresser un son tout en conservant sa qualité ? C’est dans ce contexte qu’il a développé la transformée en ondelettes, une méthode révolutionnaire pour décomposer et reconstruire des signaux. Cette avancée a eu des retombées immédiates dans des domaines aussi variés que la médecine (imagerie IRM), la télécommunication ou la restauration d’œuvres d’art numérisées.
Élodie Ramez, ingénieure en traitement d’images à l’Institut Pasteur, témoigne : Nos algorithmes de détection de cellules tumorales reposent sur des bases mathématiques directement inspirées des travaux de Mallat. Sans les ondelettes, nous aurions encore des images floues et peu exploitables. Ce genre d’impact concret est ce qui motive Mallat : Je ne cherche pas à résoudre un problème mathématique pour lui-même. Je veux comprendre ce qui se cache derrière un phénomène observable, puis transposer cette compréhension ailleurs. Ainsi, les ondelettes, initialement conçues pour l’analyse d’images, ont trouvé des applications en physique quantique, en météorologie, ou encore en finance, pour modéliser les fluctuations des marchés.
Pourquoi s’intéresser aujourd’hui aux intelligences artificielles ?
Depuis une quinzaine d’années, Stéphane Mallat a progressivement déplacé son focus vers les réseaux de neurones profonds, ces architectures informatiques à la base des IA modernes. Ce virage n’est pas anodin. Alors que ces systèmes réussissent des tâches autrefois jugées impossibles — comme traduire une langue en temps réel ou générer une image à partir d’un simple texte —, leur fonctionnement reste largement opaque. On a des boîtes noires incroyablement efficaces, mais on ne comprend pas pourquoi elles marchent , s’interroge Mallat.
Il donne un exemple parlant : Imaginez un réseau capable de reconnaître un chat sur une photo. Il le fait bien, parfois mieux qu’un humain. Mais si vous lui montez une image légèrement perturbée, il peut confondre un chat avec un camion. Pourquoi ? Qu’est-ce que cet algorithme “voit” réellement ? Ces questions ne sont pas seulement académiques. Elles ont des implications éthiques, industrielles et sécuritaires. Un système médical qui diagnostique une maladie doit être fiable, explicable, et non sujet à des erreurs inexplicables.
Camille Nguyen, chercheuse en IA à l’INRIA, travaille sur des systèmes d’aide au diagnostic. Dans notre laboratoire, on utilise des modèles d’apprentissage profond pour détecter des anomalies cardiaques sur des électrocardiogrammes. Mais quand le médecin demande “pourquoi ce résultat ?”, on ne peut souvent pas répondre. C’est frustrant, et parfois inquiétant. Le travail de Mallat nous aide à poser les bonnes questions.
Peut-on élaborer une théorie mathématique de l’apprentissage ?
C’est là tout le défi actuel de Stéphane Mallat : construire une théorie unificatrice de l’apprentissage par les machines. Il ne s’agit pas de simplement améliorer les algorithmes, mais de comprendre les principes fondamentaux qui leur permettent d’extraire de la structure à partir de données brutes. Les IA apprennent, mais sans conscience, sans intention. Elles ne comprennent pas ce qu’elles font. Pourtant, elles réussissent. Pourquoi ?
Il explore notamment les notions de représentation parcimonieuse et de hiérarchie des caractéristiques . En simplifiant, l’idée est que les bonnes IA réussissent parce qu’elles apprennent à organiser l’information en couches successives — d’abord des traits simples (lignes, contours), puis des formes complexes (yeux, museau), et enfin des concepts (visage, chat). Mallat cherche à formaliser mathématiquement ce processus, en s’appuyant sur des outils d’analyse harmonique, de géométrie différentielle, ou encore de théorie de l’information.
Ce n’est pas une quête de perfection technique, mais de compréhension profonde , insiste-t-il. Il compare cela à la physique du XIXe siècle, où les lois de la thermodynamique ont été découvertes avant qu’on comprenne la nature des atomes. On a des modèles qui fonctionnent, mais on manque encore d’une théorie fondamentale.
Comment rendre l’IA plus économe et durable ?
Un autre enjeu majeur pour Mallat est l’efficacité énergétique des modèles d’IA. Les grands modèles comme ChatGPT consomment des quantités colossales d’électricité, tant lors de leur entraînement que de leur utilisation. On ne peut pas continuer à développer des IA qui nécessitent des centaines de processeurs fonctionnant pendant des semaines. C’est insoutenable écologiquement , affirme-t-il.
Son approche consiste à repenser l’architecture même des réseaux de neurones. Plutôt que d’entasser des couches de calcul, il explore des modèles plus parcimonieux, capables de tirer parti de la structure inhérente aux données. Si on comprend mieux comment l’information est organisée, on peut concevoir des algorithmes qui apprennent avec moins de données et moins de puissance.
À Grenoble, une équipe pilotée par le chercheur Yann Le Fur travaille sur des capteurs intelligents intégrés à des dispositifs médicaux portables. On a besoin d’IA légères, capables de fonctionner sur batterie pendant des jours. Les idées de Mallat nous aident à concevoir des modèles qui s’adaptent au contexte sans tout recalculer à chaque fois.
Quel est l’impact de ce travail sur la société ?
Les recherches de Mallat ne restent pas confinées aux laboratoires. Elles interrogent notre rapport à la connaissance, à la décision automatisée, et à la confiance que nous accordons aux machines. Dans un monde où l’IA influence de plus en plus nos choix — de la santé à la justice, en passant par l’éducation —, comprendre son fonctionnement devient une nécessité démocratique.
Le philosophe des sciences Antoine Vidal voit dans ce travail une forme de réhabilitation de la rationalité . Mallat ne veut pas remplacer l’humain par la machine. Il veut que la machine devienne intelligible. C’est une démarche humaniste, au fond.
Un exemple frappant est celui des systèmes de reconnaissance faciale utilisés par les forces de l’ordre. Sans transparence, ces outils risquent de renforcer des biais ou de commettre des erreurs irréversibles. Si on ne comprend pas comment une IA prend une décision, on ne peut pas la responsabiliser , souligne Mallat. Et il ajoute : Une théorie mathématique de l’apprentissage, ce n’est pas seulement un outil pour les ingénieurs. C’est un fondement pour la justice, la sécurité, la démocratie.
Quelle est la prochaine étape pour Stéphane Mallat ?
À l’aube de cette nouvelle phase de sa carrière, Mallat continue de rassembler des équipes pluridisciplinaires. Il dirige désormais un laboratoire à l’intersection des mathématiques, de l’informatique et des sciences cognitives. Son objectif ? Proposer un cadre unifié pour l’apprentissage, inspiré autant par le cerveau humain que par les lois mathématiques.
On est encore loin d’une “théorie de tout” pour l’IA, reconnaît-il. Mais chaque petite percée nous rapproche d’un objectif plus grand : comprendre ce que signifie apprendre, pour une machine comme pour un humain.
A retenir
Pourquoi Stéphane Mallat a-t-il reçu la médaille d’or du CNRS en 2025 ?
Stéphane Mallat a été récompensé pour l’ensemble de ses travaux, notamment la création de la transformée en ondelettes, et pour son rôle de pionnier dans la compréhension mathématique des intelligences artificielles. Cette distinction marque aussi la reconnaissance des mathématiques appliquées au plus haut niveau en France.
Qu’est-ce que la transformée en ondelettes et pourquoi est-elle importante ?
Il s’agit d’une méthode mathématique permettant d’analyser et de compresser des signaux complexes, comme des images ou des sons, en les décomposant en éléments simples. Elle est aujourd’hui utilisée dans des domaines variés, de la médecine à la finance, en passant par la numérisation du patrimoine culturel.
Pourquoi les IA actuelles sont-elles mal comprises malgré leurs performances ?
Les réseaux de neurones profonds fonctionnent comme des boîtes noires : ils produisent des résultats précis, mais les mécanismes internes de leur apprentissage restent opaques. On ne sait pas toujours pourquoi ils réussissent ou échouent, ce qui pose des problèmes d’explicabilité et de confiance.
Quel est l’enjeu écologique lié aux grands modèles d’IA ?
Les modèles comme ChatGPT consomment d’énormes quantités d’énergie lors de leur entraînement, ce qui soulève des questions sur leur durabilité. Stéphane Mallat cherche à concevoir des IA plus efficaces, capables d’apprendre avec moins de ressources.
Quelle est la vision de Mallat pour l’avenir de l’intelligence artificielle ?
Il aspire à une IA compréhensible, fiable et économe, fondée sur une théorie mathématique solide de l’apprentissage. Son but n’est pas de remplacer l’humain, mais de rendre les machines intelligibles, afin qu’elles puissent servir la société de manière responsable.