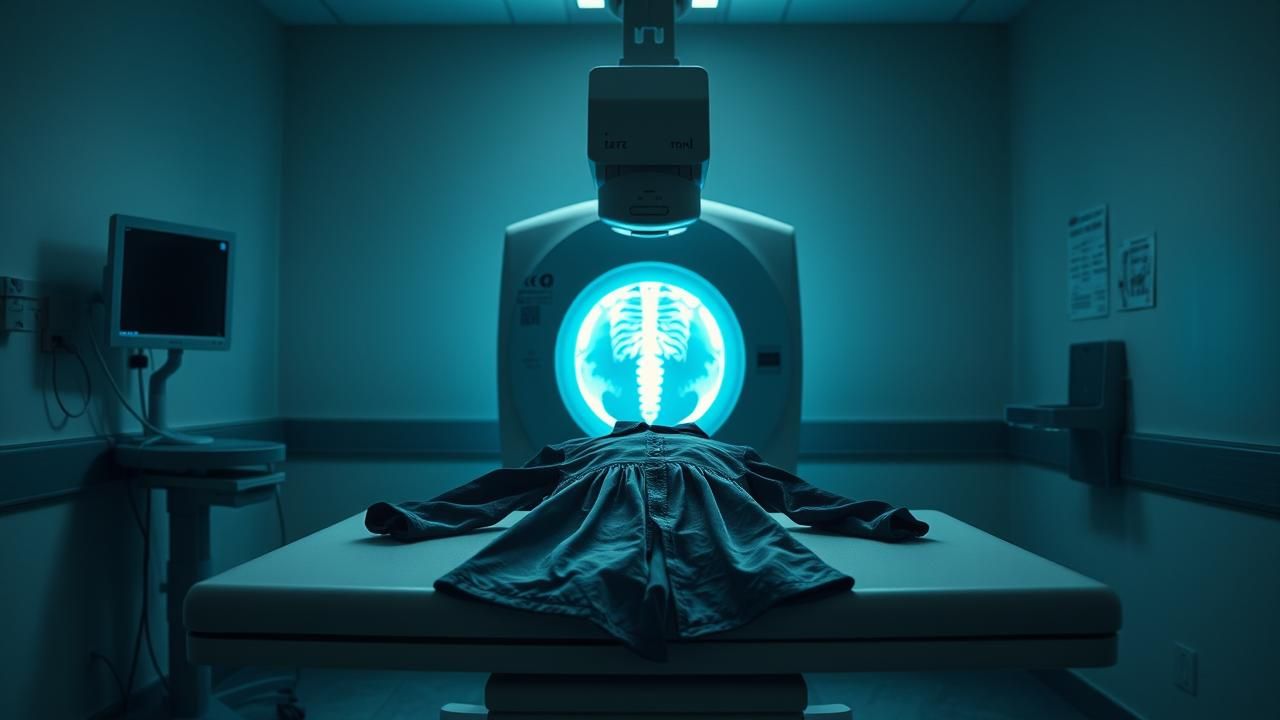En 2025, un rapport accablant de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) a révélé une faille grave dans la prise en charge des patients en radiologie au centre hospitalier de Saint-Brieuc. Pendant douze ans, de 2012 à 2024, 667 personnes, dont 451 mineurs, ont été exposées à des doses anormalement élevées de rayonnements ionisants lors d’examens radiologiques conventionnels. Ce scandale sanitaire, longtemps passé sous silence, a mis en lumière des dysfonctionnements techniques, humains et organisationnels dans un service censé garantir la sécurité des patients. Derrière ces chiffres, ce sont des vies bouleversées, des familles inquiètes, et un système qui, malgré des protocoles stricts, a laissé des erreurs s’accumuler sans être détectées. Comment une telle situation a-t-elle pu perdurer aussi longtemps ? Quelles sont les conséquences pour les patients ? Et quelles mesures ont été prises pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise ?
Qu’est-ce que la surexposition aux rayons X et pourquoi est-elle dangereuse ?
Les rayons X sont une forme de rayonnement ionisant utilisée en imagerie médicale pour visualiser les structures internes du corps. Bien maîtrisés, ils sont indispensables au diagnostic. Toutefois, une exposition excessive peut endommager les cellules, augmentant à long terme le risque de développer des cancers, notamment chez les enfants, dont les tissus sont plus sensibles. La surexposition ne provoque pas d’effets immédiats visibles, mais ses conséquences peuvent apparaître des années plus tard, rendant le suivi médical des victimes particulièrement crucial.
Quels sont les risques spécifiques pour les enfants ?
Les mineurs, qui représentent plus de 67 % des patients concernés, sont les plus vulnérables. Leur croissance rapide et la division cellulaire accrue multiplient les risques de mutations induites par les radiations. Selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, les protocoles d’imagerie doivent être adaptés à la taille et à l’âge des enfants. Or, dans le cas de Saint-Brieuc, des protocoles standardisés pour adultes ont été appliqués à des enfants, entraînant des doses bien supérieures aux seuils recommandés.
Comment a-t-on découvert cette surexposition ?
La découverte n’est pas due à une alerte interne, mais à une inspection de routine de l’ASNR en 2024. Lors d’un audit technique, les experts ont remarqué des anomalies dans les paramètres de calibration des appareils de radiologie. Une analyse rétrospective des dossiers a révélé que depuis 2012, des examens répétés — notamment des radiographies thoraciques et abdominales — avaient été réalisés avec des réglages inadaptés. Le logiciel de gestion des doses, censé alerter en cas de dépassement, n’avait pas été correctement configuré, ni régulièrement vérifié.
Y avait-il des signes avant-coureurs ?
Plusieurs professionnels du service de radiologie avaient exprimé des inquiétudes dès 2018. Léa Moreau, technicienne en imagerie médicale au CH de Saint-Brieuc pendant sept ans, témoigne : Nous avions remarqué que certains examens nécessitaient des temps d’exposition anormalement longs. On a signalé cela à plusieurs reprises, mais on nous répondait que c’était dû à la qualité des images recherchées. Ces alertes, souvent formulées oralement ou par des courriels internes, n’ont jamais déclenché d’enquête formelle ni de mise en conformité.
Pourquoi les erreurs ont-elles duré aussi longtemps ?
Le rapport de l’ASNR pointe plusieurs causes structurelles. D’abord, un défaut de maintenance des équipements. Les appareils, bien que récents, n’avaient pas fait l’objet de vérifications régulières de leurs paramètres de dose. Ensuite, une absence de formation continue du personnel. Beaucoup de techniciens ne connaissaient pas les outils de suivi dosimétrique, ou ne les utilisaient pas systématiquement , explique le Dr Élias Renard, expert en radioprotection consulté par l’enquête.
Enfin, une culture du silence. Dans un milieu médical souvent hiérarchisé, remettre en question les pratiques établies peut être perçu comme une forme de remise en cause de l’autorité. On ne veut pas passer pour celui qui fait des vagues , confie un ancien radiologue du centre, sous couvert d’anonymat. Ce climat a permis à des dysfonctionnements de s’installer durablement.
Le rôle des logiciels de gestion des doses
Les logiciels informatiques utilisés en radiologie permettent de tracer chaque exposition, d’alerter en cas de seuil dépassé et de produire des rapports automatisés. Or, à Saint-Brieuc, ces outils étaient sous-utilisés. Le système avait été paramétré avec des seuils trop élevés, et les alertes désactivées pour éviter les fausses alarmes . Une décision prise localement, sans validation technique ni contrôle externe, qui a eu des conséquences dramatiques.
Quelles sont les conséquences pour les patients ?
Les effets biologiques d’une surexposition aux rayons X ne sont pas immédiatement visibles, mais l’anxiété des patients et de leurs familles est réelle. Camille Ferrand, mère d’un garçon de 11 ans examiné plusieurs fois entre 2016 et 2020 pour des douleurs abdominales, raconte : On nous disait que c’était des examens simples, sans danger. Aujourd’hui, je me demande si son asthme, qui s’est aggravé l’année dernière, n’est pas lié à ça.
Le centre hospitalier a mis en place un dispositif de suivi médical pour les 667 patients concernés. Ce suivi inclut des consultations spécialisées, des évaluations dosimétriques individuelles et un accompagnement psychologique. Toutefois, le sentiment d’abandon persiste chez certains. On nous a envoyé un courrier impersonnel, sans explication claire, sans rendez-vous fixé. C’est comme s’ils voulaient enterrer l’affaire , déplore Julien Berthier, un patient adulte ayant subi plus de dix radiographies à fortes doses.
Quelles mesures ont été prises pour éviter un nouveau drame ?
Le CH Yves-Le-Foll affirme avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des patients . Depuis 2024, tous les appareils de radiologie ont été recalibrés. Un nouveau protocole de contrôle qualité hebdomadaire a été instauré, avec des relevés systématiques des doses administrées. Le personnel a suivi une formation renforcée en radioprotection, et un comité de surveillance interne a été créé, incluant des représentants des patients.
La mise en place d’un système de vigilance renforcé
Un système de vigilance médicale automatisé a été déployé, intégrant des alertes en temps réel dès qu’un seuil de dose est approché. Chaque examen est désormais validé par un médecin radiologue avant traitement, et les dossiers des mineurs font l’objet d’un double contrôle. Ce n’est plus une question de confiance, mais de traçabilité , précise Aurore Lenoir, nouvelle responsable du service d’imagerie.
Quelles responsabilités sont en jeu ?
L’ASNR n’a pas attribué de sanctions pénales, mais a transmis son rapport à l’Agence régionale de santé (ARS) et au parquet de Saint-Brieuc. Une enquête administrative est en cours pour déterminer si des manquements intentionnels ou une négligence caractérisée peuvent être retenus contre certains responsables. Plusieurs anciens cadres du service ont été mis en disponibilité.
La responsabilité des fabricants d’appareils
Le rapport mentionne également une faille dans le processus de maintenance des équipements, réalisée par une entreprise sous-traitante. Cette société, chargée de la calibration, aurait omis de signaler des dérives techniques répétées. Une enquête est ouverte pour vérifier si des rapports de maintenance ont été falsifiés ou minimisés. Le constructeur des appareils, quant à lui, affirme que ses instructions d’utilisation étaient claires et que la responsabilité incombe à l’hôpital en matière de suivi.
Quel avenir pour la radioprotection en France ?
L’affaire de Saint-Brieuc n’est pas isolée. En 2023, un incident similaire avait été signalé dans un hôpital du sud de la France, bien que sur une échelle moindre. Ces événements soulignent un besoin urgent de renforcer la culture de la sécurité en imagerie médicale. L’ASNR préconise désormais des audits aléatoires dans tous les établissements de plus de 500 lits, ainsi qu’un système national de déclaration obligatoire des surexpositions.
La nécessité d’un suivi national des doses
Un projet de registre national des expositions médicales aux rayonnements ionisants est en cours de développement. Ce registre permettrait de suivre chaque patient tout au long de sa vie, en centralisant toutes ses expositions, et d’alerter en cas d’accumulation excessive. Ce type d’outil aurait pu détecter l’anomalie de Saint-Brieuc bien plus tôt , estime le Pr Claire Dubois, membre du conseil scientifique de l’ASNR.
Comment les patients peuvent-ils se protéger ?
La vigilance des patients est un levier essentiel. Poser des questions simples — Est-ce que cet examen est vraiment nécessaire ? , Quelle est la dose prévue ? , Y a-t-il une alternative sans rayons ? — peut inciter les professionnels à revoir leurs pratiques. Les familles doivent également conserver un historique des examens médicaux, surtout pour les enfants.
L’importance du dialogue médecin-patient
Le Dr Élias Renard insiste sur le rôle du médecin prescripteur : Il ne suffit pas de demander une radio. Il faut s’assurer que l’établissement dispose des protocoles adaptés, surtout pour les enfants. Le dialogue entre prescripteur et radiologue est fondamental.
Quelle est la conclusion de cette affaire ?
L’affaire de Saint-Brieuc est un cas d’école de ce qui peut arriver lorsque la technique, l’organisation et la culture de sécurité s’effritent. Elle montre que même dans des hôpitaux modernes, des erreurs invisibles peuvent avoir des conséquences durables. Elle impose une révision des pratiques, un renforcement des contrôles, et surtout, une écoute plus grande des professionnels de terrain et des patients. La confiance en la médecine se reconstruit pas à pas, avec transparence et responsabilité.
A retenir
Quel est le nombre de patients concernés par la surexposition à Saint-Brieuc ?
667 patients ont été identifiés comme ayant été surexposés entre 2012 et 2024, dont 451 étaient mineurs au moment des examens.
Qui a découvert l’incident ?
L’incident a été découvert par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) lors d’un audit de routine en 2024, après des années de dysfonctionnements passés inaperçus.
Quelles mesures ont été prises pour protéger les patients ?
Le centre hospitalier a recalibré ses appareils, instauré des contrôles hebdomadaires, formé son personnel à la radioprotection, et mis en place un suivi médical et psychologique pour les patients concernés.
Les patients risquent-ils de développer un cancer ?
Le risque individuel est faible, mais réel, surtout pour les enfants. Le suivi médical vise à détecter précocement d’éventuelles complications. Aucun cas avéré de cancer lié à cette surexposition n’a été signalé à ce jour.
Y a-t-il eu des sanctions ?
Aucune sanction pénale n’a été prononcée à ce stade, mais une enquête administrative est en cours. Plusieurs cadres ont été mis en disponibilité, et des responsabilités pourraient être engagées.
Comment éviter qu’un tel incident se reproduise ?
Par la mise en place de contrôles indépendants, de logiciels d’alerte fiables, d’une formation continue du personnel, et d’un registre national des expositions. La transparence et la culture de la vigilance doivent devenir des priorités absolues.