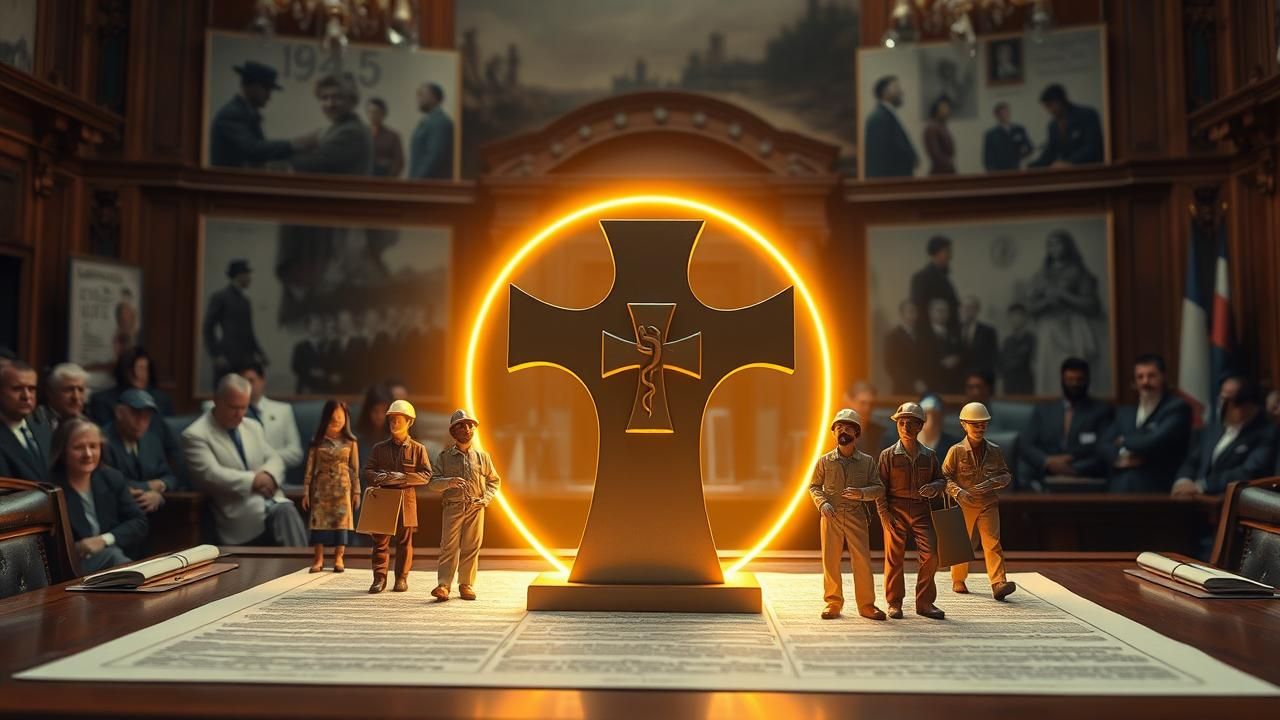Quatre-vingts ans après sa création, la Sécurité sociale, pilier fondateur de la protection sociale française, fait face à un nouveau défi : son inscription dans la Constitution. Alors que l’interruption volontaire de grossesse a été inscrite dans le marbre constitutionnel en 2024 après un vote quasi unanime, les communistes entendent désormais étendre cette démarche symbolique et juridique à un autre droit fondamental : la protection universelle des soins. À l’initiative de deux députés, Yannick Monnet et Stéphane Peu, une proposition de loi vise à inscrire les principes de la Sécurité sociale dans la Constitution, dans un contexte de tensions sociales, de pressions libérales et d’incertitudes économiques. Ce geste, à la fois politique et symbolique, interroge autant sur la pérennité du modèle français que sur l’avenir de la solidarité nationale.
En 2025, l’idée d’inscrire la Sécurité sociale dans la Constitution n’est pas une simple provocation politique. Elle s’inscrit dans un climat de défiance croissante vis-à-vis des réformes du système de santé, des débats sur la privatisation de certains services publics, et des pressions pour basculer vers un modèle assurantiel, où le financement des soins reposerait davantage sur l’impôt ou les assurances complémentaires. Pour Yannick Monnet, député de l’Allier, cette évolution serait une rupture avec l’esprit originel de la Sécurité sociale. En 1945, la Sécu a été conçue comme un droit universel, fondé sur la solidarité intergénérationnelle et la cotisation des travailleurs. Aujourd’hui, ce principe est mis à mal par des logiques marchandes qui risquent d’exclure les plus fragiles
, affirme-t-il lors d’un déjeuner-débat à l’Assemblée nationale.
Le témoignage de Camille Fournier, infirmière libérale à Saint-Étienne, illustre cette inquiétude. J’ai vu des patients renoncer à des soins parce que leur mutuelle ne couvre pas certains actes. On glisse vers une médecine à deux vitesses. La Sécu, c’est ce qui nous protège encore de ça. Mais si on ne la renforce pas, elle finira par s’effriter
, raconte-t-elle. Son collègue, le docteur Élias Benmoussa, généraliste dans un quartier populaire de Marseille, renchérit : Dans mon cabinet, 40 % de mes patients sont en ALD. Sans la Sécurité sociale, ils ne pourraient pas se soigner. Ce n’est pas un système parfait, mais c’est un rempart contre la précarité sanitaire
.
Pourquoi une inscription constitutionnelle ?
Les initiateurs de la proposition de loi insistent sur le caractère symbolique et protecteur de cette mesure. Graver les principes de la Sécurité sociale dans la Constitution, c’est les mettre à l’abri des caprices des majorités politiques
, explique Stéphane Peu, député de Seine-Saint-Denis. C’est dire clairement que ce n’est pas un service public parmi d’autres, mais un droit fondamental, au même titre que l’éducation ou la liberté d’expression
.
Historiquement, la création de la Sécurité sociale en 1945 par les ordonnances du Conseil national de la Résistance a marqué un tournant dans l’histoire sociale française. Elle reposait sur trois piliers : universalité, solidarité et gestion par les partenaires sociaux. Aujourd’hui, ces fondements sont perçus comme fragilisés. Le financement par les cotisations sociales, souvent remis en question au profit de prélèvements fiscaux, est au cœur du débat. La cotisation, c’est le lien entre le travail et la protection. Si on remplace ça par l’impôt, on casse la logique du système
, souligne Élodie Lemaire, économiste spécialisée en protection sociale.
Le cas de Thomas Rivière, ancien cadre dans une entreprise de logistique, illustre cette crainte. Après un licenciement économique, il a perdu sa mutuelle d’entreprise. J’ai dû attendre plusieurs mois pour être couvert à nouveau. Pendant ce temps, j’ai repoussé une opération du genou. Ce n’est pas normal qu’un citoyen doive subir ça dans un pays comme le nôtre
, dit-il amèrement.
Quels principes devraient être inscrits ?
La proposition de loi vise à inscrire plusieurs principes clés dans la Constitution. D’abord, l’universalité de la protection sociale : tout résident en France aurait droit à une couverture maladie, quel que soit son statut professionnel ou sa situation. Ensuite, le financement par les cotisations sociales, excluant toute substitution par des prélèvements fiscaux ou des assurances privées. Enfin, une gouvernance paritaire, où les représentants des salariés, des employeurs et des travailleurs indépendants auraient un rôle central dans la gestion du système.
C’est cette dimension de gouvernance qui touche particulièrement Lucie Berthier, déléguée syndicale dans une entreprise de transports à Lyon. Quand on parle de réforme de la Sécu, on consulte les experts, les économistes, mais rarement les usagers. Pourtant, ce sont les travailleurs qui la financent chaque mois. Ils doivent avoir leur mot à dire
, insiste-t-elle.
Le modèle suédois ou allemand, où les partenaires sociaux participent activement à la gestion des caisses de santé, est souvent cité comme exemple. En France, cette logique a été progressivement affaiblie, au profit d’une gestion plus étatique. On a perdu ce lien entre la base et les décisions
, regrette Malik Zidane, ancien administrateur d’une caisse primaire d’assurance maladie. Aujourd’hui, tout se décide à Bercy ou à la Direction de la Sécurité sociale. Ce n’est plus vraiment un système de protection sociale, mais une administration
.
Quel est l’avenir de cette proposition ?
Les initiateurs de la loi savent que le chemin sera long. L’inscription d’un droit dans la Constitution suppose une révision constitutionnelle, qui nécessite soit un référendum, soit une adoption par le Parlement réuni en Congrès à Versailles, à la majorité des trois cinquièmes. Or, le soutien politique n’est pas garanti. Si plusieurs députés de la gauche plurielle ont déjà exprimé leur sympathie pour le texte, les rangs de la majorité présidentielle restent partagés.
Clara Vasseur, députée écologiste du Gard, se dit favorable à l’objectif, mais prudente sur la méthode. Je comprends la volonté de protéger la Sécu, mais il faut aussi moderniser le système. L’inscrire dans la Constitution ne doit pas devenir un prétexte pour bloquer toute évolution
, tempère-t-elle. De son côté, le sénateur Julien Mercier, membre du groupe Les Républicains, critique une démarche idéologique
. La Constitution n’est pas un cahier de doléances. Elle doit énoncer des principes fondamentaux, pas des choix de gestion
, affirme-t-il.
Malgré ces obstacles, Yannick Monnet reste optimiste. Nous avons vu, avec le droit à l’IVG, que des sujets considérés comme bloqués peuvent devenir des causes nationales. La Sécu, c’est pareil. C’est un bien commun. Personne ne devrait pouvoir y toucher sans l’accord du peuple
.
Quels impacts concrets pour les citoyens ?
Si la proposition venait à aboutir, elle ne changerait pas immédiatement le fonctionnement quotidien de la Sécurité sociale. Mais elle créerait un cadre juridique plus robuste, rendant plus difficile toute privatisation ou démantèlement progressif. Elle pourrait aussi renforcer la légitimité des revendications sociales autour de la protection des soins.
Pour Aïcha Ndiaye, mère célibataire à Lille, ce type de mesure a un sens concret. Chaque mois, je paie mes cotisations. Je ne vis pas dans l’abondance, mais je sais que si mon fils tombe malade, on sera soignés. Ce sentiment de sécurité, c’est ce que la Sécu me donne. Je ne veux pas qu’on me le retire un jour
, dit-elle.
Le débat dépasse largement les cercles politiques. Dans les réunions de quartier, les cafés, les syndicats, on sent monter une inquiétude diffuse. On a l’impression que tout peut être vendu, tout peut être remis en cause
, observe Daniel Kessler, retraité à Strasbourg. La Sécu, c’est l’un des derniers acquis qui nous rassure. Si on la perd, qu’est-ce qui reste ?
Conclusion
L’initiative des députés Monnet et Peu ne se résume pas à une manœuvre parlementaire. Elle s’inscrit dans une volonté plus large de redonner du sens à la solidarité nationale, de rappeler que certains droits ne doivent pas être soumis aux aléas des politiques économiques. L’inscription de la Sécurité sociale dans la Constitution serait un acte fondateur, au même titre que celle de l’IVG. Elle ne résoudrait pas à elle seule les défis financiers, démographiques ou organisationnels du système de santé, mais elle poserait un socle intangible : celui de la protection universelle et solidaire. Dans un monde en mutation, où les inégalités se creusent, ce type de garantie pourrait devenir un pilier essentiel de la cohésion sociale.
A retenir
Elle consacrerait juridiquement les principes fondamentaux du système : universalité de la couverture, financement par les cotisations sociales, et gestion paritaire. Cela rendrait plus difficile toute remise en cause de ces principes par une future majorité politique.
Pourquoi les communistes poussent-ils cette initiative maintenant ?
Le contexte social et économique incertain, combiné à des pressions libérales sur la protection sociale, pousse à vouloir protéger la Sécu des évolutions qu’ils jugent dangereuses. L’exemple de l’IVG, inscrite en 2024, montre que de tels textes peuvent aboutir avec un large consensus.
Quel est le principal obstacle à cette réforme ?
L’adoption d’une révision constitutionnelle nécessite une majorité qualifiée au Congrès. Or, l’absence de soutien unanime de la majorité présidentielle et d’autres groupes politiques rend le chemin très incertain.
Est-ce que cela changerait le fonctionnement de la Sécu au quotidien ?
Non, pas immédiatement. L’effet serait surtout symbolique et juridique : garantir que les principes fondateurs ne puissent pas être remis en cause sans un accord large du corps social et politique.
Les ordonnances de 1945 ont établi un système fondé sur la solidarité et la cotisation. Aujourd’hui, les promoteurs de l’inscription constitutionnelle veulent préserver cet héritage face aux logiques marchandes et aux réformes qui tendent à le fragiliser.