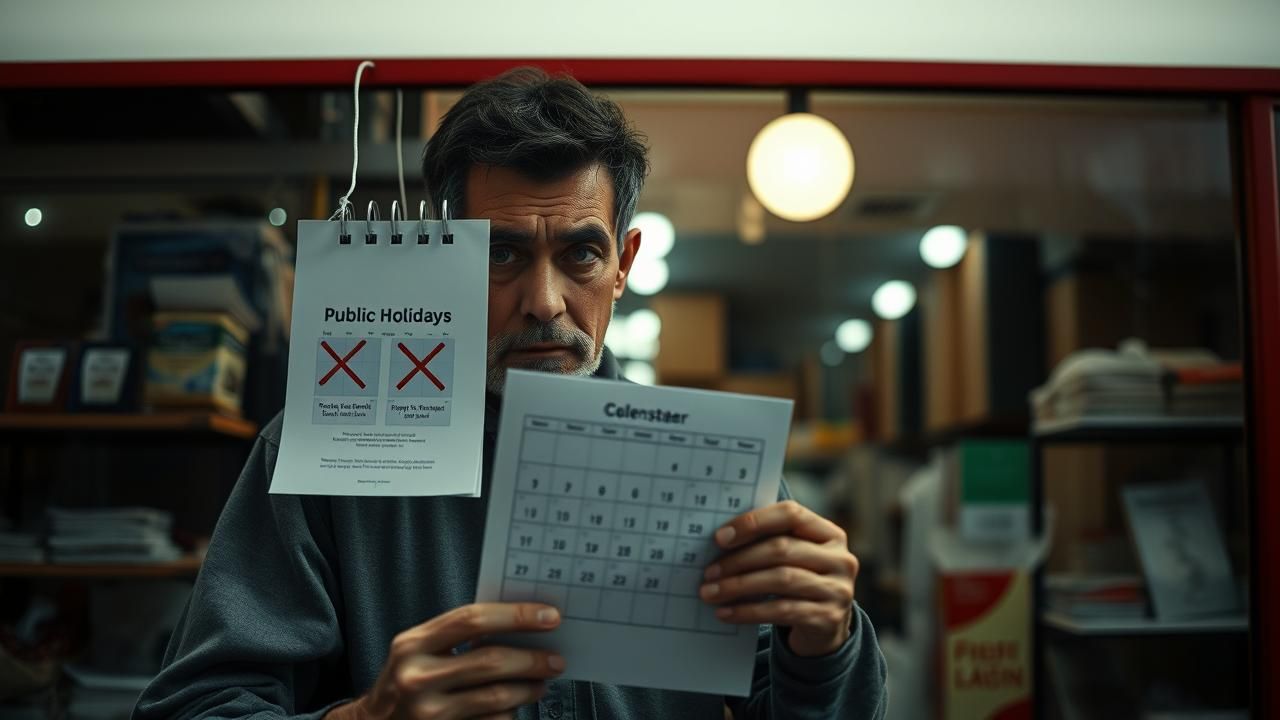Alors que le gouvernement prépare le budget 2026, une proposition de suppression de deux jours fériés fait déjà trembler les fondations du monde économique et social. Transmise par François Bayrou aux partenaires sociaux, cette mesure vise à générer des économies budgétaires sans augmenter la rémunération des salariés mensualisés ni des agents publics. Une réforme apparemment technique, mais dont les effets concrets pourraient s’avérer profondément disruptifs. Entre gains hypothétiques pour l’État et pertes tangibles pour les entreprises, notamment les petites et moyennes structures, le débat s’enflamme. Michel Picon, président de l’Union des entreprises de proximité (U2P), sonne l’alarme : cette mesure, selon lui, est non seulement mal calibrée, mais dangereuse. À l’approche de l’automne, où les tensions sociales pourraient s’accumuler, les acteurs économiques appellent à une réflexion plus fine, plus inclusive, et surtout, plus réaliste.
Quels changements concrets apporterait la suppression de deux jours fériés ?
La suppression de deux jours fériés ne se traduirait pas simplement par deux jours de travail supplémentaires dans l’année. Elle bouleverserait des équilibres économiques fragiles, notamment dans les secteurs saisonniers ou à forte intensité de main-d’œuvre. L’idée du gouvernement est claire : transformer deux jours chômés en jours travaillés sans surcoût salarial. En théorie, cela permettrait de gagner en productivité sans alourdir la charge publique. Mais dans la pratique, les effets sont loin d’être linéaires.
Michel Picon pointe du doigt l’absence totale de cadrage solide. “On nous demande de discuter d’une mesure dont personne ne connaît les impacts réels”, s’insurge-t-il. Selon lui, chaque secteur réagit différemment à ces interruptions : l’industrie peut compenser un jour perdu, mais le commerce de détail, l’artisanat ou le tourisme dépendent directement des flux de consommation. Supprimer un jour férié, c’est potentiellement supprimer une journée de chiffre d’affaires.
À Lyon, Camille Lenoir, gérante d’un petit restaurant bio dans le quartier de la Croix-Rousse, témoigne : “Le lundi de Pentecôte, c’est un jour de grande affluence. Les gens sortent, déjeunent en famille, profitent du week-end prolongé. Si on doit ouvrir ce jour-là sans que les clients soient plus nombreux, on paie des charges fixes, on mobilise l’équipe, mais sans revenus supplémentaires. C’est une perte sèche.”
Les chiffres évoqués par les professionnels sont alarmants : l’hôtellerie-restauration perdrait environ 100 millions d’euros par jour férié supprimé. Pour les territoires touristiques comme la Côte d’Azur ou la Bretagne, la perspective est inquiétante. “Les gens planifient leurs déplacements autour des ponts. Enlever un jour, c’est réduire les séjours, les réservations, les activités”, explique Julien Ferrand, directeur d’un centre de loisirs à Annecy. “On ne travaille pas plus, on perd juste une opportunité.”
Picon insiste : “Travailler davantage ne crée pas de rentabilité par magie. Ce sont les carnets de commandes, la trésorerie, et surtout la consommation des ménages qui pilotent l’activité.” Sans demande accrue, la simple imposition de jours supplémentaires risque de générer de la frustration, des désorganisations, et une pression inutile sur les équipes.
Qui supporterait réellement le coût de cette réforme ?
Loin d’être une simple mesure d’économie, la suppression des jours fériés ressemble, selon l’U2P, à un transfert de charge déguisé. “L’État ne fait pas des économies, il va chercher 4,2 milliards d’euros dans la poche des entreprises”, assène Michel Picon. Pour les TPE et PME, cette somme ne provient pas de bénéfices excédentaires, mais d’une marge déjà serrée.
Prenez l’exemple d’un salon de coiffure à Bordeaux, tenu par Élodie Vasseur. Chaque jour d’ouverture implique des coûts fixes : loyer, électricité, charges sociales, et salaires. “Si je dois ouvrir un jour férié sans clients, je paie tout, mais je ne gagne rien”, explique-t-elle. “Et je dois en plus verser la contribution de 0,30 % pour les heures travaillées ce jour-là. C’est absurde.”
Le paradoxe est criant : le gouvernement veut stimuler l’activité économique, mais impose une mesure qui pénalise les secteurs qui en dépendent le plus. Les artisans, les commerçants de proximité, les prestataires de services, tous soulignent le même constat : sans demande, le travail supplémentaire ne crée pas de richesse. “On est loin du ‘travailler plus pour gagner plus’”, résume Picon. “Ici, on travaille plus pour perdre plus.”
La clé, selon les professionnels, réside dans la solvabilité des ménages. “Ce n’est pas le calendrier qui stimule l’économie, c’est le pouvoir d’achat”, affirme Camille Lenoir. “Si les gens ont moins d’argent, ils sortent moins, achètent moins, et les jours fériés ou pas, les caisses restent vides.”
La relation entre employeurs et salariés est aussi en jeu. “Mes équipes comptent sur ces jours pour se reposer, voir leur famille”, poursuit Élodie Vasseur. “Les priver de ces moments, c’est risquer de les démobiliser. Et quand le moral baisse, la qualité du service aussi.”
Depuis quarante-deux ans, la France tente de concilier équilibre budgétaire et justice sociale. Michel Picon rappelle que certaines décisions passées, comme la retraite à 60 ans ou la réduction à 35 heures, ont été prises sans financement clair, générant des tensions durables. “On ne peut pas continuer à improviser des ajustements structurels sans en mesurer les conséquences”, prévient-il.
La suppression de jours fériés, dans ce contexte, risque de devenir un symbole de rupture. “Les entreprises de proximité portent l’emploi local, animent les centres-villes, soutiennent les territoires”, souligne Picon. “Les fragiliser, c’est fragiliser tout le tissu économique.”
À Lille, Thomas Régnier, gérant d’une librairie indépendante, voit déjà les effets collatéraux. “Les jours fériés, c’est souvent l’occasion pour les gens de venir flâner, acheter un livre, participer à un atelier. Si on supprime ces moments, on perd aussi du lien social.” Pour lui, la mesure risque d’accélérer la désertification commerciale des centres-villes, déjà fragilisés par le commerce en ligne.
Le climat social inquiète aussi. “Si cette réforme passe sans concertation, on va vers un mécontentement profond”, prévient Picon. “Les salariés se sentiront spoliés, les entrepreneurs acculés, et les territoires les plus vulnérables, les premiers touchés.” Il appelle à un débat franc, chiffré, et surtout, inclusif : “On ne peut pas décider de l’avenir du travail depuis un bureau à Bercy, sans connaître la réalité des boutiques, des ateliers, des restaurants.”
Quelles alternatives pour une réforme du temps de travail plus équilibrée ?
Plutôt que de supprimer des jours fériés, Michel Picon propose une autre voie : augmenter légèrement la durée quotidienne de travail. “Par exemple, passer de 7h à 7h15 de travail par jour. Cela fait gagner du temps sans choc frontal, et surtout, sans détruire des journées entières de repos.”
Cette approche, dit-il, respecte les rythmes des entreprises et des salariés. Elle permettrait une hausse progressive de la productivité, sans rupture. “C’est une évolution, pas une révolution. Et c’est plus acceptable socialement.”
Il suggère aussi de mieux accompagner les jeunes et les seniors vers l’emploi. “Beaucoup de chômeurs ne sont pas inactifs par choix, mais par manque de parcours clairs, de formation, d’incitations.” En investissant dans l’insertion, plutôt que dans des mesures calendaire, la France pourrait gagner en compétitivité sans sacrifier le bien-être collectif.
Des expériences locales montrent que d’autres modèles sont possibles. À Montpellier, un groupement d’artisans a expérimenté un système de modulation horaire : ouverture prolongée certains jours, fermeture compensée d’autres jours. “On a gagné en flexibilité, les clients sont contents, et les équipes aussi”, raconte Sophie Marquant, responsable d’un atelier de céramique. “Le travail, ce n’est pas juste un nombre de jours. C’est une organisation intelligente.”
Le débat sur les jours fériés n’est pas qu’un débat budgétaire. Il touche à l’identité du modèle français : équilibre entre travail, repos, et vie sociale. Pour éviter une impasse, Michel Picon appelle à une méthode différente : une négociation structurée, appuyée sur des données publiques, des études d’impact sectorielles et territoriales.
“On a besoin de transparence, pas de décrets”, insiste-t-il. “Les petites entreprises ne demandent pas des privilèges, elles demandent de la visibilité, de la stabilité, et des règles du jeu claires.”
Les entreprises veulent des horaires intelligents, adaptés aux flux, et un lien clair entre effort et revenu. “Si on travaille plus, qu’on gagne plus, ou qu’on crée des emplois. Sinon, à quoi bon ?” demande Camille Lenoir.
Un retrait prudent de la mesure, ou une expérimentation ciblée, pourrait éviter un risque inutile. “On n’est pas contre le travail, on est contre les mauvaises solutions”, résume Thomas Régnier. “On veut une économie vivante, pas un calendrier vide.”
Conclusion
La suppression de deux jours fériés, telle qu’envisagée, risque de produire l’effet inverse de celui recherché. Au lieu de dynamiser l’économie, elle pourrait affaiblir les petites entreprises, réduire la consommation, et tendre un climat social déjà fragile. La clé du succès réside non pas dans des mesures administratives, mais dans une approche globale : mieux travailler, pas forcément plus. En mettant l’accent sur la productivité, l’insertion, et la solvabilité des ménages, la France pourrait trouver un équilibre durable. Mais cela passe par un dialogue sincère, des données fiables, et surtout, le respect de la réalité du terrain.
A retenir
Quelle est la mesure proposée par le gouvernement ?
Le gouvernement envisage de supprimer deux jours fériés en 2026, en transformant ces jours chômés en jours travaillés, sans augmentation de la rémunération des salariés mensualisés ni des agents publics. Cette mesure vise un gain budgétaire estimé à 4,2 milliards d’euros.
Pourquoi l’U2P s’oppose-t-elle à cette réforme ?
Michel Picon, président de l’U2P, juge la mesure “inacceptable” et “dangereuse”. Il dénonce un manque de cadrage, des impacts négatifs sur les TPE/PME, et un risque de casse sociale. Selon lui, travailler plus ne crée pas de richesse si la demande n’augmente pas.
Quels secteurs seraient les plus touchés ?
Les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie-restauration, du commerce de proximité et de l’artisanat seraient fortement impactés. Ces filières dépendent des flux de consommation liés aux jours fériés et risquent de perdre des millions d’euros de chiffre d’affaires par jour supprimé.
Qui paierait réellement le coût de cette suppression ?
Les petites et moyennes entreprises assumeraient l’essentiel du coût, via des charges fixes non compensées par des recettes supplémentaires. L’U2P parle d’un transfert de charge de l’État vers les entreprises, sans création de valeur.
Quelles alternatives sont proposées ?
Michel Picon suggère d’augmenter légèrement la durée quotidienne de travail plutôt que de supprimer des jours entiers, et de mieux accompagner les jeunes et seniors vers l’emploi. Il plaide pour une négociation basée sur des études d’impact réelles et une approche plus flexible du temps de travail.