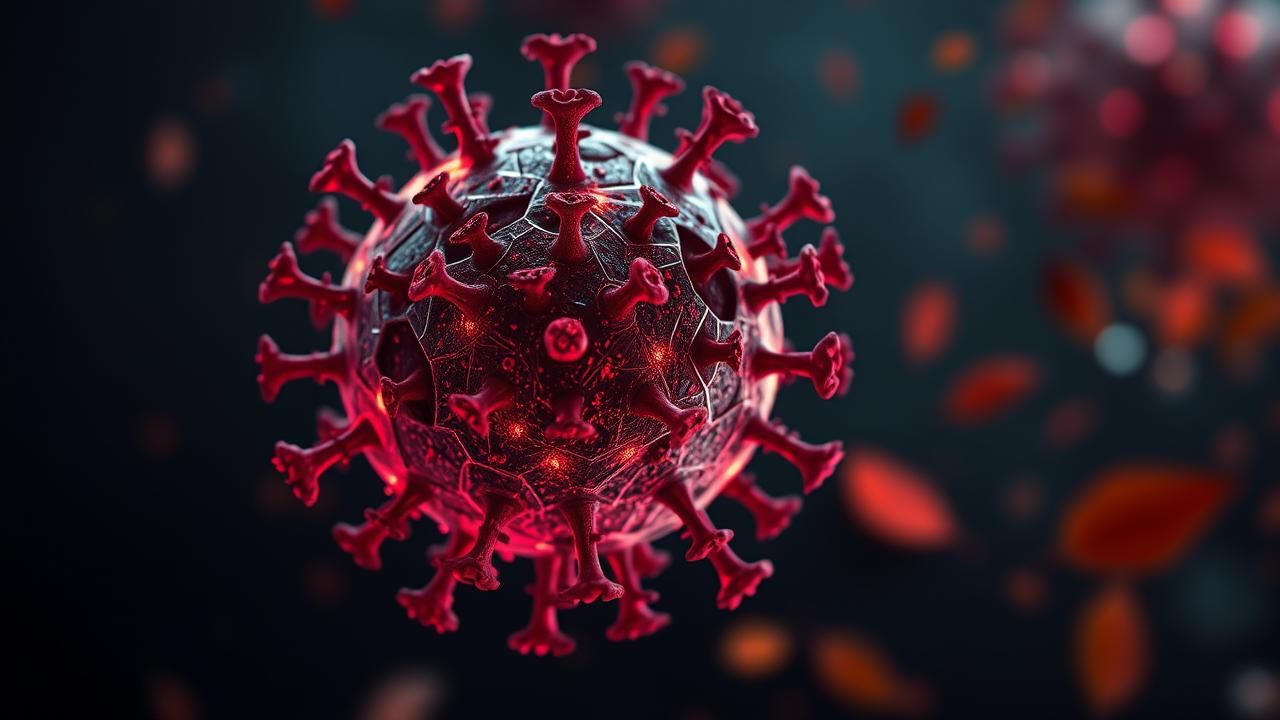Alors que les feuilles tombent et que l’automne s’installe, une nouvelle vague de contaminations au Covid-19 redessine le paysage sanitaire européen. En France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, un variant aux allures inquiétantes s’impose progressivement : le XFG, surnommé Frankenstein . Ce nom, bien qu’alarmiste, révèle une réalité scientifique complexe : une hybridation inédite entre plusieurs sous-variants d’Omicron, qui pourrait expliquer sa propagation accélérée. Si les symptômes restent comparables à ceux d’un rhume ou d’une grippe bénigne, les autorités sanitaires surveillent de près cette souche, classée sous surveillance par l’Organisation mondiale de la santé depuis la fin juin. Derrière ce surnom sensationnel, se cache une mutation insidieuse, mais aussi une leçon d’humilité face à l’évolution incessante du virus.
Qu’est-ce que le variant Frankenstein et pourquoi ce nom ?
Le variant XFG, surnommé Frankenstein , n’est pas une création officielle de la communauté scientifique, mais une appellation populaire née sur les réseaux sociaux et relayée par certains médias. Ce sobriquet fait référence au célèbre personnage littéraire du roman de Mary Shelley, un monstre assemblé à partir de morceaux de corps différents. De la même manière, XFG serait le fruit d’une recombinaison génétique entre deux sous-variants d’Omicron : LF.7 et LP.8.1.2. Cette hybridation, rare mais possible, se produit lorsque deux souches circulent simultanément dans un même individu, permettant au virus de bricoler un nouveau génome en combinant des segments d’ARN.
C’est Émilie, biologiste à l’Institut Pasteur, qui explique : On observe de plus en plus de phénomènes de recombinaison avec Omicron. Le virus circule encore suffisamment pour que ces rencontres entre variants aient lieu. XFG est un hybride, un peu comme un enfant de deux souches parentes. Ce n’est pas un monstre, mais une évolution logique dans un contexte de circulation virale persistante.
Comment XFG se distingue-t-il des autres variants ?
Une meilleure évasion immunitaire grâce à sa spicule
La particularité de XFG réside dans les mutations présentes sur sa protéine Spike, la fameuse clé que le virus utilise pour pénétrer les cellules humaines. Ces mutations, héritées des deux variants parentaux, lui permettent d’échapper plus efficacement aux anticorps, qu’ils proviennent d’une vaccination ou d’une infection antérieure. C’est ce qui explique sa transmissibilité accrue, même si sa virulence – la gravité de la maladie qu’il provoque – ne semble pas augmentée.
Le professeur Antoine Lefebvre, infectiologue à l’hôpital de Nantes, précise : Ce que nous voyons, c’est une poussée automnale classique, mais amplifiée par un variant qui contourne mieux nos défenses. Ce n’est pas une nouvelle pandémie, mais un rappel que le virus continue de s’adapter.
Une propagation rapide en Europe et aux États-Unis
Dans plusieurs régions de France, notamment en Bourgogne-Franche-Comté et dans les Pays de la Loire, les indicateurs sanitaires montrent une remontée des cas depuis mi-septembre. Les tests positifs augmentent, tout comme les consultations pour symptômes respiratoires. Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) signalent une croissance similaire, avec XFG devenu dominant en quelques semaines.
À Rennes, Clément, 68 ans, diabétique de type 2, a été testé positif fin septembre. J’avais fait toutes mes doses de vaccin, mais je me suis dit que ce n’était plus la peine de me protéger autant. J’ai baissé la garde. Et là, toux, fièvre, fatigue… Je me suis retrouvé cloué au lit pendant cinq jours. Mon médecin m’a dit que c’était probablement ce nouveau variant qui circule.
Les symptômes sont-ils différents ?
Un tableau clinique proche de la grippe
Les symptômes associés à XFG ne diffèrent pas fondamentalement de ceux observés avec les précédents variants d’Omicron. On retrouve notamment : fièvre modérée, maux de tête, courbatures, toux sèche, et mal de gorge. Certains patients rapportent aussi une fatigue prolongée, parfois accompagnée de troubles digestifs ou de pertes d’odorat, bien que ces derniers soient moins fréquents qu’au début de la pandémie.
Camille, infirmière libérale dans la région lyonnaise, note : Ce que je vois en ce moment, c’est une vague de rhinopharyngites atypiques. Des gens qui pensaient avoir un simple rhume, mais dont le test Covid est positif. Souvent, ils sont surpris parce qu’ils se sentaient “presque bien”. Mais en deux jours, ça peut s’aggraver, surtout chez les personnes fragiles.
Un risque accru pour les personnes vulnérables
Bien que XFG ne semble pas plus dangereux en soi, son pouvoir de transmission accru augmente le risque d’exposition pour les personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques. Ces groupes restent les plus exposés aux formes sévères de la maladie, y compris aux hospitalisations.
Marie, 72 ans, retraitée à Dijon, témoigne : J’ai été vaccinée trois fois, mais mon médecin m’a conseillé de me faire rappeler cette année. Avec mon hypertension, je ne veux pas prendre de risques. Mon petit-fils a eu le Covid il y a deux semaines, et j’ai préféré ne pas le voir pendant dix jours.
Quelles sont les recommandations des autorités sanitaires ?
Une campagne de vaccination synchronisée avec celle de la grippe
Face à cette remontée des cas, les autorités sanitaires ont décidé d’aligner la campagne de rappel contre le Covid-19 sur celle de la grippe. Elle débute le 14 octobre, date à partir de laquelle les personnes éligibles – notamment les plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques, et les professionnels de santé – pourront se faire vacciner.
Le vaccin proposé est un rappel bivalent, ciblant à la fois le variant original du SARS-CoV-2 et les souches Omicron circulantes. Bien que XFG ne soit pas explicitement visé, les experts estiment que cette formulation offre une protection suffisante grâce à la réponse immunitaire croisée.
Des mesures barrières à ne pas négliger
Si le port du masque n’est plus obligatoire, les autorités recommandent de le réintroduire dans les lieux clos et bondés, notamment les transports en commun, les centres commerciaux, ou lors des visites à risque (hôpitaux, EHPAD). La ventilation des pièces, le lavage des mains et l’isolement en cas de symptômes restent des gestes simples mais efficaces.
On sort d’un été où tout le monde pensait que le Covid était derrière nous , observe le Dr Lefebvre. Mais les virus ne disparaissent pas, ils évoluent. Et tant qu’il y aura de la circulation, il y aura des risques.
L’OMS en alerte : que signifie sous surveillance ?
Un statut qui reflète une vigilance accrue
L’Organisation mondiale de la santé a classé XFG comme sous surveillance depuis la fin juin. Ce statut, intermédiaire entre les variants d’intérêt et les variants préoccupants, signifie que le variant présente des caractéristiques génétiques inquiétantes, mais que les données sur sa dangerosité restent insuffisantes. L’OMS suit notamment son taux de propagation, son impact clinique, et sa capacité à contourner l’immunité.
Être “sous surveillance” ne veut pas dire qu’il y a urgence , nuance Émilie, la biologiste. C’est une étape de vigilance. On collecte des données, on compare les séquences, on étudie les cas. Si jamais on observe une augmentation significative des formes graves, le statut pourrait évoluer.
Un réseau mondial de surveillance génomique
La détection de XFG a été possible grâce aux réseaux de séquençage mis en place pendant la pandémie. En France, Santé Publique France collabore avec les laboratoires de biologie médicale pour analyser un échantillon représentatif des cas positifs. Ce système, bien que réduit par rapport à 2020-2021, reste opérationnel.
En Écosse, où XFG a été identifié tôt, les scientifiques du UK Health Security Agency ont pu alerter rapidement leurs homologues européens. C’est un bon exemple de coopération internationale , souligne Émilie. Sans ces échanges, on serait toujours dans le noir.
Le variant Frankenstein : une menace ou une alarme médiatique ?
Un surnom qui alimente l’inquiétude
Le terme Frankenstein a été largement utilisé par les médias, les réseaux sociaux, et même certains scientifiques dans des interviews. S’il permet de vulgariser une notion complexe – la recombinaison virale –, il risque aussi de susciter une anxiété disproportionnée. Ce n’est pas un monstre , insiste le professeur Lefebvre. C’est un virus qui mute, comme tous les virus. Le problème, c’est que ce nom fait peur, et la peur nuit à la compréhension.
Un risque de désinformation en cascade
Sur les réseaux, certains ont affirmé que XFG était plus dangereux que Delta ou qu’il rendait les vaccins obsolètes . Ces affirmations, démenties par les données actuelles, circulent malgré tout. On voit revenir les mêmes discours qu’en 2020 , regrette Camille, l’infirmière. Des gens refusent de se faire vacciner, d’autres paniquent pour rien. Il faut du discernement.
Quelle place pour le Covid-19 dans la santé publique aujourd’hui ?
Le variant XFG, bien qu’inquiétant par sa propagation, ne marque pas un retour à l’état d’urgence sanitaire. Il illustre plutôt la transition vers une gestion endémique du virus, comparable à celle de la grippe. Le défi désormais est de maintenir une vigilance soutenue, sans sombrer dans la panique ni dans la négligence.
On ne reverra probablement jamais les scènes de mars 2020 , estime Émilie. Mais on doit apprendre à vivre avec ce virus, en restant alerte, en se protégeant quand il le faut, et en continuant à se faire vacciner.
A retenir
Qu’est-ce que le variant XFG, dit Frankenstein ?
Le variant XFG est une souche recombinante du SARS-CoV-2, issue de la fusion de deux sous-variants d’Omicron : LF.7 et LP.8.1.2. Son surnom, non scientifique, fait référence à son origine hybride, mais ne reflète pas une virulence accrue.
Pourquoi est-il plus transmissible ?
XFG présente des mutations sur sa protéine Spike qui lui permettent d’échapper plus facilement à l’immunité acquise par vaccination ou infection antérieure. Cela augmente sa capacité à se propager, sans pour autant rendre la maladie plus grave.
Quels sont les groupes à risque ?
Les personnes âgées, celles souffrant de maladies chroniques (diabète, hypertension, insuffisance respiratoire), et les immunodéprimées restent les plus vulnérables. Elles sont particulièrement encouragées à se faire vacciner lors de la campagne de rappel.
Quand a lieu la nouvelle campagne de vaccination ?
La campagne de rappel contre le Covid-19 débute le 14 octobre 2025, en même temps que celle de la grippe. Elle cible les personnes éligibles, notamment les plus de 65 ans et les personnes à risque.
Faut-il s’inquiéter de ce nouveau variant ?
Il n’est pas nécessaire de paniquer, mais il est essentiel de rester vigilant. Le variant XFG circule activement, et sa propagation peut être limitée par la vaccination, les gestes barrières, et une bonne information. La peur ne doit pas guider les comportements, mais la prudence reste de mise.