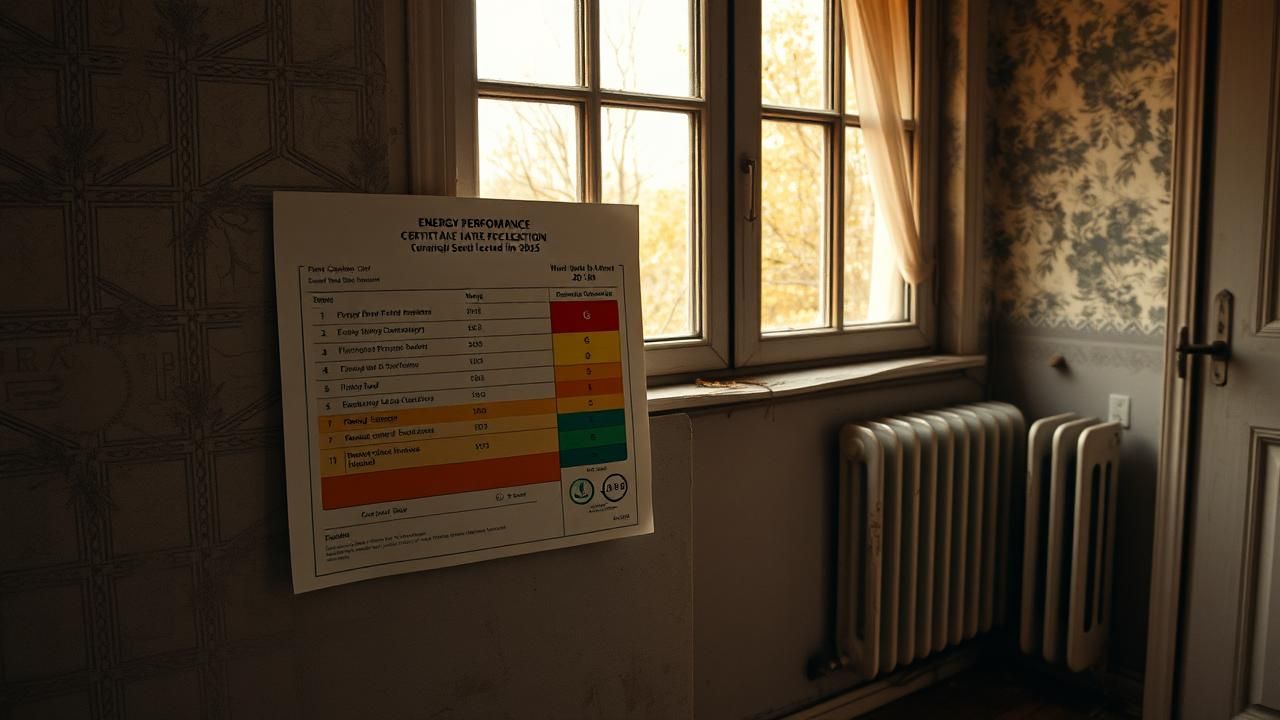À l’approche de l’automne 2025, les feuilles roussissent, les soirées s’allongent, et les propriétaires sentent poindre une inquiétude bien plus tangible que la baisse des températures : celle de voir leur logement stigmatisé par un DPE défavorable. Dans un marché immobilier en pleine mutation, la performance énergétique n’est plus un simple indicateur technique, mais un levier de valeur — voire un piège financier. Alors que les passoires thermiques sont de plus en plus mal vues, que les banques durcissent leurs conditions de financement, et que les acheteurs font du DPE leur premier critère de sélection, la question se pose avec urgence : un mauvais diagnostic peut-il réellement faire perdre des dizaines de milliers d’euros ? Entre témoignages de vendeurs désarçonnés, stratégies d’investisseurs avisés et analyses de courtiers, plongée dans une réalité immobilière où le thermomètre énergétique pèse désormais plus lourd que jamais.
Pourquoi la note énergétique bouleverse le jeu immobilier en 2025
Des acheteurs toujours plus exigeants face à la transition écologique
Le regard des acquéreurs a profondément changé. Jadis secondaire, la note énergétique est devenue le sésame d’un achat réussi. Clémentine Laroche, architecte de 38 ans, raconte sa recherche d’un appartement à Lyon : J’ai visité une jolie maison ancienne dans le 5e arrondissement. Belle charpente, parquet d’époque, mais un DPE en G. Dès que je l’ai vu, j’ai senti un frein. Pas seulement pour l’image, mais pour le coût réel : 3 500 € par an en chauffage ? C’est un crédit à part entière. Ce ressenti, de plus en plus partagé, illustre une mutation profonde. Les ménages ne se contentent plus d’un toit, ils cherchent un bien durable, pérenne, économique. Les classes A, B ou C attirent une demande galvanisée par les crises énergétiques passées, mais aussi par une prise de conscience écologique sincère. Selon une étude récente, les biens énergétiquement performants restent en moyenne 40 % moins longtemps sur le marché que leurs homologues mal classés. Ils bénéficient aussi d’une prime moyenne de 12 % sur le prix d’achat. Un atout concurrentiel décisif.
L’influence croissante des politiques publiques et du secteur bancaire
Le cadre réglementaire n’a jamais été aussi contraignant. Depuis janvier 2025, la location des logements classés G est interdite, et les annonces immobilières doivent désormais afficher, en gras et en première page, la classe énergétique du bien. Cette mesure, destinée à accélérer la rénovation du parc ancien, a un effet immédiat sur les prix de vente. Les investisseurs ont peur, confie Malik Téboul, courtier à Toulouse. Un bien en G, c’est une perte de potentiel locatif, donc une perte de valeur. Même s’il est bien situé, il devient un casse-tête. Le secteur bancaire suit le mouvement. De nombreuses institutions exigent désormais un DPE minimum pour accorder un prêt, ou proposent des taux préférentiels pour les biens rénovés. Un taux réduit de 0,3 %, ça peut faire 15 000 € d’économie sur un crédit de 25 ans, souligne Malik. Les acheteurs intelligents l’ont compris. Le DPE devient donc un acteur financier à part entière, influant directement sur l’accessibilité du bien.
Passoire thermique : plus de 20 % de décote à la vente, légende urbaine ou tsunami bien réel ?
Dernières tendances du marché dans les grandes villes
À Paris, Bordeaux ou Nantes, les logements en F ou G ne sont pas encore des parias, mais ils sont clairement pénalisés. Dans ces métropoles, la décote moyenne oscille entre -8 % et -12 %. La demande est si forte qu’un bon emplacement peut compenser un mauvais DPE, explique Élodie Fresson, négociatrice immobilière à Bordeaux. Mais attention : les acheteurs savent qu’ils devront investir. Ils négocient en conséquence. En revanche, en zone rurale ou dans les petites villes, le constat est sans appel. Un bien mal classé peut perdre jusqu’à 25 % de sa valeur. À Saint-Amand-Montrond, en Centre-Val de Loire, un pavillon de 120 m² en DPE G a vu son prix chuter de 190 000 € à 140 000 € en six mois, malgré une baisse initiale de 15 %. Il n’y avait plus de visiteurs, raconte son propriétaire, Étienne Vasseur. Même en affichant un prix bas, les gens hésitaient. Ils voyaient les travaux à faire, et ils reculaient.
Exemples concrets de pertes de valeur selon la classe DPE
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Un appartement de 60 m², bien situé, affiché à 3 000 €/m², vaut 180 000 €. Mais si son DPE est en F ou G, sa valeur marchande s’effondre. Selon les zones, la décote atteint 27 000 à 45 000 €. À Lille, un duplex ancien en DPE F a été vendu 210 000 €, alors que les comparables bien isolés dépassent les 250 000 €. L’acheteur a négocié 35 000 € de rabais, sachant qu’il devrait dépenser 20 000 € en isolation et menuiseries , confirme un agent local. Le paradoxe ? Les biens mal classés attirent parfois plus de contacts — jusqu’à 67 % de plus que les biens en D — mais ces contacts se transforment rarement en offre sérieuse. C’est une curiosité, pas un engagement , résume Clémentine Laroche, qui a visité plusieurs passoires thermiques par curiosité, mais sans jamais s’engager.
Quand votre logement passe du coup de cœur à la mauvaise pioche
Les signaux rédhibitoires pour les acheteurs et l’explosion des marges de négociation
En 2025, un DPE en F ou G agit comme un signal d’alarme. C’est immédiat, décrit Malik Téboul. Les acheteurs sortent leur calculatrice. Ils additionnent les factures d’énergie, les travaux à prévoir, les risques réglementaires futurs. Ce calcul devient vite dissuasif. Dans les annonces, la mention DPE en cours ou classe F suffit à faire fuir une partie du marché. Et pour ceux qui restent, la marge de négociation s’envole. On voit des demandes de baisse de 20 %, parfois plus, surtout si le bien est en campagne , témoigne Élodie Fresson. À Reims, un couple a acquis une maison ancienne en DPE G après une négociation de 28 %, sachant qu’ils allaient bénéficier de MaPrimeRénov. On a fait le pari que les aides couvriraient une grande partie des travaux , explique Camille, 34 ans. Un scénario de plus en plus courant, mais qui repose sur une capacité d’investissement que tous n’ont pas.
Le DPE, premier filtre lors des visites et en ligne
Le diagnostic énergétique est devenu le premier critère de tri. Avant même la surface ou la proximité des écoles, 90 % des acheteurs consultent la note énergétique. Sur les plateformes comme SeLoger ou Bien’ici, les biens en A ou B reçoivent en moyenne trois fois plus de clics que les autres. C’est un effet de halo, analyse Malik. Un bon DPE donne une impression de sérieux, de modernité. À l’inverse, les passoires thermiques, même bien placées, souffrent d’un déficit d’image. On me dit souvent : “C’est joli, mais le DPE…” , raconte Étienne Vasseur. Et pourtant, certains biens mal classés se vendent — à condition d’être très bien positionnés sur le prix. Le marché ne rejette pas les passoires, il les pénalise , résume Élodie Fresson.
Rénover ou vendre tel quel : le dilemme stratégique pour préserver la valeur
Le coût d’une rénovation énergétique et sa rentabilité sur la valeur du bien
Face à la décote, la rénovation s’impose comme une solution logique. Isolation des combles, remplacement des fenêtres, installation d’une chaudière basse consommation : le coût moyen d’une rénovation énergétique complète s’élève à 18 000 € pour un logement de 80 m². Mais le retour sur investissement est réel. La valeur du bien augmente souvent de 5 à 10 % après les travaux , affirme Élodie Fresson. À Montpellier, un appartement rénové de 75 m² est passé de 270 000 € à 295 000 € en trois mois, et a trouvé acquéreur en six semaines. Les acheteurs voient que les travaux sont faits, qu’il n’y a plus de surprise , explique le propriétaire, Hugo Delmas. De plus, les aides publiques — MaPrimeRénov, éco-prêt à taux zéro, TVA réduite — rendent ces projets accessibles à un plus grand nombre.
Scénarios de revente selon la note énergétique
Les scénarios divergent radicalement selon la classe énergétique. Un bien rénové, même ancien, attire une clientèle plus large, plus motivée, et se vend plus vite. À l’inverse, un bien non rénové en F ou G reste longtemps sur le marché, accumule les visites sans suite, et finit souvent par céder à une décote sévère. J’ai vu des vendeurs perdre patience, baisser le prix de 20 %, et encore négocier à la baisse , confie Malik Téboul. Une réforme du DPE annoncée pour janvier 2026 pourrait toutefois redistribuer les cartes. Les logements chauffés à l’électricité, souvent pénalisés dans les DPE actuels, pourraient bénéficier d’une meilleure évaluation, ce qui relancerait leur attractivité. Ceux qui attendent cette réforme pour vendre risquent de gagner du terrain , prédit Élodie Fresson.
Les clés pour bien agir face à une note DPE peu avantageuse
Les risques financiers d’un mauvais DPE : synthèse
Ignorer le DPE, c’est prendre le risque d’une décote de 10 à 17 %, voire plus de 1 000 €/m² dans certaines zones. C’est aussi s’exposer à une mise sur le marché prolongée, à une perte d’attractivité, et à l’impossibilité de louer à l’avenir. Le coût d’un mauvais DPE n’est plus théorique, il est comptable , insiste Malik Téboul. Pour les propriétaires, la question n’est plus de savoir si le DPE compte, mais comment l’intégrer dans leur stratégie de vente.
Conseils pratiques pour réussir sa vente malgré tout
- Anticiper les travaux : un audit énergétique réalisé avant la mise en vente rassure les acquéreurs et permet de cibler les rénovations prioritaires.
- Valoriser les atouts : même sans rénovation, un bien peut séduire par son emplacement, sa typologie, ou son potentiel. Mettre en avant les aides disponibles est un argument fort.
- Réfléchir à la stratégie de prix : afficher un prix réaliste, voire légèrement attractif, peut compenser un DPE défavorable et attirer des investisseurs prêts à rénover.
- Suivre les évolutions réglementaires : la réforme du DPE 2026 pourrait profiter aux logements chauffés à l’électricité. S’informer permet de mieux calibrer son timing de vente.
Conclusion
En 2025, le DPE n’est plus un simple document administratif : c’est un acteur central du marché immobilier. Il influence les prix, conditionne l’accessibilité au crédit, et modifie les comportements d’achat. Vendre un logement mal classé, c’est accepter de subir une décote, de perdre du temps, et de s’exposer à des risques financiers croissants. Mais ce n’est pas une fatalité. En anticipant, en rénovant, ou en adoptant une stratégie de prix réaliste, il reste possible de tirer parti d’un bien ancien. Le défi est désormais de transformer la contrainte énergétique en opportunité de valorisation. Car dans ce nouveau jeu, la performance thermique n’est plus une option : c’est la clé de la valeur.
A retenir
Un DPE en F ou G peut-il faire perdre de l’argent à la vente ?
Oui, concrètement. Selon les zones, la décote varie entre -8 % en ville et -28 % en milieu rural. En moyenne, un logement mal classé perd entre 10 % et 17 % de sa valeur marchande, sans compter les coûts indirects liés à une mise sur le marché prolongée.
Faut-il rénover avant de vendre ?
Dans la majorité des cas, oui. Une rénovation énergétique coûte entre 15 000 et 25 000 €, mais elle peut augmenter la valeur du bien de 5 à 10 %. Elle attire aussi plus d’acheteurs, accélère la vente, et améliore les conditions de financement.
Les banques refusent-elles des crédits pour les passoires thermiques ?
Elles ne refusent pas systématiquement, mais elles durcissent leurs conditions. De nombreuses banques exigent un DPE minimum ou appliquent des taux plus élevés pour les biens mal isolés. Certains établissements offrent des taux préférentiels pour les logements économes.
Un bien en DPE G peut-il encore se vendre ?
Oui, mais à condition d’être stratégique. Un prix attractif, un bon emplacement, ou la perspective de rénovations aidées peuvent séduire des investisseurs ou des primo-accédants. Cependant, les marges de négociation sont importantes, et la vente prend souvent plus de temps.
La réforme du DPE en 2026 va-t-elle tout changer ?
Potentielle. Elle devrait revaloriser les logements chauffés à l’électricité, souvent pénalisés aujourd’hui. Ceux qui attendent cette réforme pour vendre pourraient bénéficier d’une meilleure note, donc d’une meilleure valorisation. Mais cela suppose de bien anticiper les évolutions réglementaires.